
Sign up to save your podcasts
Or


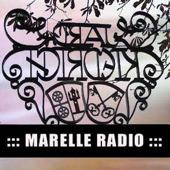

Laura Ulonati redonne vie à Wasif Jawhariyyeh, musicien et chroniqueur palestinien du début du XXᵉ siècle, témoin des métamorphoses de Jérusalem. À travers sa voix, la romancière fait vibrer une cité où coexistaient juifs, musulmans, orthodoxes et chrétiens, avant qu'elle ne se fracture sous les coups de l'Histoire. Le roman mêle mémoire intime et destin collectif. Plus qu'un récit historique, ce roman à l'écriture lyrique et sensorielle, transforme le réel en chant, dans une alternance de tranches de vie du personnage central, et textes beaucoup plus courts, qui restituent la ville aujourd'hui. Ce livre est une célébration de l'Histoire de Jérusalem et de la Palestine, d'un passé que les tenants d'une mémoire sélective aimeraient effacer et que ce livre voudrait partager.
J'étais roi à Jérusalem, Laura Ulonati, Actes Sud, 2025.
Pour trouver le repos, il faut savoir pour qui ou pour quoi on meurt. C'est ce que demandaient Ali et son doux visage abîmé.
Quand ce fut mon tour, je tirai de ma poche un carreau de faïence brun foncé ; une tesselle presque aussi noire qu'un morceau de charbon. L'un des tisons qui ornaient la sépulture de mon père.
C'est ce qu'il se dit en mordant dans son casse-croûte. Pourtant, il doit lui aménager un havre de paix ; un jardin sous la muraille orientale de cette Jérusalem empierrée. Ville toute minérale dont les toits sont devenus des citadelles grillagées, armoriées de drapeaux bleus du ciel mais n'offrant plus d'aire de repos à ce passereau.
Grâce à son travail, on cultivera bientôt des arbres, et le bulbul sera peut-être rejoint par des étourneaux. Nuées de milliers, de dizaines de milliers d'oiseaux qu'il aime observer chaque année dans leur traversée d'Israël. À l'automne, le pays est une étape dans leur grand périple d'ouest en est. Un orchestre sans frontière qui nécessite davantage de branches afin de protéger son sommeil des rapaces.
Cette pensée lui fait mieux apprécier le bulbul. Il le trouve sympathique après tout, avec ses joues blanches et son croupion jaune ; avec sa huppe noire au sommet de sa tête de linotte. Un crâne de piaf qui le fait picorer toujours au même endroit la terre grise et usée du cimetière musulman de Yosefiya. Une poussière qu'il vient de retourner au bulldozer et qui n'a manifestement rien à offrir au pauvre moineau. “Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau”, mais des dentures entières. Des os flottant à la surface des sépultures éventrées.
Après sa pause déjeuner, il finira de les enfoncer dans le sol. De les terrasser avant de les recouvrir d'un tapis de gazon déposé carré par carré. Un contreplaqué d'herbe pour effacer ce qui préexistait ; la limite entre les vivants et les morts, entre Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est. Une guerre pour l'éternité.
Et pour les niais qui la chercheront encore, on répondra qu'elle est enterrée sous cette ligne verte. Une jolie coulée bien coloriée sur tous les plans de la ville. Une promenade urbaine et écologique longeant les vieux murs, les pentes lisses et arasées du “parc national des Remparts de Jérusalem”.
Le casse-croûte englouti, il ne tarde pas à s'y remettre. Les soldats qui gardent l'entrée du chantier sont sur les nerfs : les opposants au projet semblent chaque jour plus nombreux à repousser.
Il doit s'attaquer au carré des enfants. Ça lui serre un peu le bide – sans doute l'effet de la digestion – mais, après tout, il le fait pour que d'autres enfants viennent jouer ici en écoutant pépier le printemps. Ils y fabriqueront de meilleurs souvenirs.
Sauf que le passé pense à lui.
Sauf qu'en écrasant la première rangée de petites tombes, les chenilles de son bulldozer font remonter ce qu'il préférait ignorer.
Dans leur cycle infernal et infini, lui revient le souvenir de son fils mort-né. Ce bébé qui l'avait laissé “thekla”. L'hébreu est l'une des seules langues à posséder un mot pour dire l'indicible. Une rare parole pour raconter ce qui n'est jamais dans l'ordre des choses : un parent orphelin de son enfant.
Cette précision existe dans une autre langue de la souffrance ; l'arabe où elle se dit “shakoul”.
Tout grésille dans le bruit des chenilles. Ça se brouille devant ses yeux dans un ballet d'images parasites. Une danse hypnotique qui dessine dans sa tête comme dans la neige d'un vieux téléviseur les voiles d'un bateau, puis un serpent, un squelette psalmodiant le Coran, un fusil d'assaut. Une main qui lancerait une pierre, le vol étourdissant des étourneaux. Adam qui se souvient de son argile. Un bulbul transformé en bulldozer, en Orphée aux Enfers.
Il se précipite hors de sa cabine pour dégueuler dans la poussière grise.
Le bulbul sautille gaiement jusqu'à la flaque acide nageant entre ses pieds. Son crâne de piaf a enfin trouvé de quoi manger.
J'étais roi à Jérusalem, Laura Ulonati, Actes Sud, 2025.
Vous pouvez suivre le podcast de ces lectures versatiles sur les différents points d'accès ci-dessous :
RSS | Apple Podcast | Youtube | Deezer | Spotify
 View all episodes
View all episodes


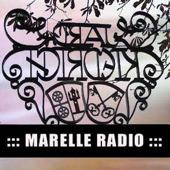 By Pierre Ménard
By Pierre Ménard
Laura Ulonati redonne vie à Wasif Jawhariyyeh, musicien et chroniqueur palestinien du début du XXᵉ siècle, témoin des métamorphoses de Jérusalem. À travers sa voix, la romancière fait vibrer une cité où coexistaient juifs, musulmans, orthodoxes et chrétiens, avant qu'elle ne se fracture sous les coups de l'Histoire. Le roman mêle mémoire intime et destin collectif. Plus qu'un récit historique, ce roman à l'écriture lyrique et sensorielle, transforme le réel en chant, dans une alternance de tranches de vie du personnage central, et textes beaucoup plus courts, qui restituent la ville aujourd'hui. Ce livre est une célébration de l'Histoire de Jérusalem et de la Palestine, d'un passé que les tenants d'une mémoire sélective aimeraient effacer et que ce livre voudrait partager.
J'étais roi à Jérusalem, Laura Ulonati, Actes Sud, 2025.
Pour trouver le repos, il faut savoir pour qui ou pour quoi on meurt. C'est ce que demandaient Ali et son doux visage abîmé.
Quand ce fut mon tour, je tirai de ma poche un carreau de faïence brun foncé ; une tesselle presque aussi noire qu'un morceau de charbon. L'un des tisons qui ornaient la sépulture de mon père.
C'est ce qu'il se dit en mordant dans son casse-croûte. Pourtant, il doit lui aménager un havre de paix ; un jardin sous la muraille orientale de cette Jérusalem empierrée. Ville toute minérale dont les toits sont devenus des citadelles grillagées, armoriées de drapeaux bleus du ciel mais n'offrant plus d'aire de repos à ce passereau.
Grâce à son travail, on cultivera bientôt des arbres, et le bulbul sera peut-être rejoint par des étourneaux. Nuées de milliers, de dizaines de milliers d'oiseaux qu'il aime observer chaque année dans leur traversée d'Israël. À l'automne, le pays est une étape dans leur grand périple d'ouest en est. Un orchestre sans frontière qui nécessite davantage de branches afin de protéger son sommeil des rapaces.
Cette pensée lui fait mieux apprécier le bulbul. Il le trouve sympathique après tout, avec ses joues blanches et son croupion jaune ; avec sa huppe noire au sommet de sa tête de linotte. Un crâne de piaf qui le fait picorer toujours au même endroit la terre grise et usée du cimetière musulman de Yosefiya. Une poussière qu'il vient de retourner au bulldozer et qui n'a manifestement rien à offrir au pauvre moineau. “Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau”, mais des dentures entières. Des os flottant à la surface des sépultures éventrées.
Après sa pause déjeuner, il finira de les enfoncer dans le sol. De les terrasser avant de les recouvrir d'un tapis de gazon déposé carré par carré. Un contreplaqué d'herbe pour effacer ce qui préexistait ; la limite entre les vivants et les morts, entre Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est. Une guerre pour l'éternité.
Et pour les niais qui la chercheront encore, on répondra qu'elle est enterrée sous cette ligne verte. Une jolie coulée bien coloriée sur tous les plans de la ville. Une promenade urbaine et écologique longeant les vieux murs, les pentes lisses et arasées du “parc national des Remparts de Jérusalem”.
Le casse-croûte englouti, il ne tarde pas à s'y remettre. Les soldats qui gardent l'entrée du chantier sont sur les nerfs : les opposants au projet semblent chaque jour plus nombreux à repousser.
Il doit s'attaquer au carré des enfants. Ça lui serre un peu le bide – sans doute l'effet de la digestion – mais, après tout, il le fait pour que d'autres enfants viennent jouer ici en écoutant pépier le printemps. Ils y fabriqueront de meilleurs souvenirs.
Sauf que le passé pense à lui.
Sauf qu'en écrasant la première rangée de petites tombes, les chenilles de son bulldozer font remonter ce qu'il préférait ignorer.
Dans leur cycle infernal et infini, lui revient le souvenir de son fils mort-né. Ce bébé qui l'avait laissé “thekla”. L'hébreu est l'une des seules langues à posséder un mot pour dire l'indicible. Une rare parole pour raconter ce qui n'est jamais dans l'ordre des choses : un parent orphelin de son enfant.
Cette précision existe dans une autre langue de la souffrance ; l'arabe où elle se dit “shakoul”.
Tout grésille dans le bruit des chenilles. Ça se brouille devant ses yeux dans un ballet d'images parasites. Une danse hypnotique qui dessine dans sa tête comme dans la neige d'un vieux téléviseur les voiles d'un bateau, puis un serpent, un squelette psalmodiant le Coran, un fusil d'assaut. Une main qui lancerait une pierre, le vol étourdissant des étourneaux. Adam qui se souvient de son argile. Un bulbul transformé en bulldozer, en Orphée aux Enfers.
Il se précipite hors de sa cabine pour dégueuler dans la poussière grise.
Le bulbul sautille gaiement jusqu'à la flaque acide nageant entre ses pieds. Son crâne de piaf a enfin trouvé de quoi manger.
J'étais roi à Jérusalem, Laura Ulonati, Actes Sud, 2025.
Vous pouvez suivre le podcast de ces lectures versatiles sur les différents points d'accès ci-dessous :
RSS | Apple Podcast | Youtube | Deezer | Spotify