
Sign up to save your podcasts
Or


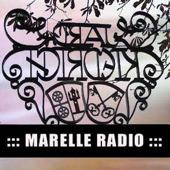

Thomas Hunkeler mène une enquête littéraire et historique sur le masque mortuaire du philosophe allemand qui est conservé aux Archives littéraires allemandes de Marbach, près de Stuttgart. À partir d'une lettre d'André Breton à Paul Éluard mentionnant son existence, il interroge son authenticité et sa signification. Thomas Hunkeler révèle la fascination pour ces objets funéraires, tout en proposant une histoire parallèle du surréalisme. Entre mythe et réalité, ce masque s'avère trace du défunt aussi bien que projection de ceux qui l'observent. Dans cette mise en récit d'un essai, entre érudition et esprit d'investigation, Thomas Hunkeler éclaire un pan méconnu du rapport des avant-gardes à la mort et à l'héritage des figures intellectuelles, tout en s'attachant à montrer la « dimension collective de la poétique du masque mortuaire ».
Le masque de Hegel, Thomas Hunkeler, Seuil, Collection Fiction & Cie, 2025.
Sa face a quelque chose de brut, de brutal presque : l'impression première est celle d'une masse épaisse et lourde. À peine visibles, ses traits sont comme estompés, gommés, à l'exception de la bouche qui semble vouloir exprimer une certaine fermeté, tout comme la lourde mâchoire. Les yeux que l'on devine à peine sont fermés, comme s'ils avaient sombré dans la masse du visage, sous les cernes ; seuls les sourcils, broussailleux, et le nez parfaitement droit donnent du relief à la figure. Le front, haut, porte la trace de quelques rares mèches de cheveux qui ressemblent étrangement à des rides verticales. Il y a quelque chose de fruste et de mal dégrossi dans cette figure. En allemand, j'utiliserais à ce propos le terme grobschlächtig, qui fait résonner, à côté de la notion de grossièreté, celle de schlagen, « battre », mais sous une forme désuète, schlächtig, que l'on retrouve de nos jours surtout dans l'appellation de celui qui abat les bêtes, le Schlachter. Serait-ce la face d'un boucher ?
2.
C'est en parcourant la correspondance d'André Breton et Paul Éluard que j'ai découvert l'existence du masque mortuaire de Hegel. On y apprend qu'en janvier 1929, au moment où il vient de repartir de Paris à Arosa, dans les Grisons suisses, pour soigner sa santé, Éluard s'arrête à Bâle, ville frontière, pour envoyer à Breton un ouvrage qu'il vient de découvrir dans une librairie le « Totenmasken », comme il l'écrit. Il s'agit du livre de l'historien de l'art allemand Ernst Benkard, Das ewige Antlitz. Eine Sammlung von Totenmasken (La Face éternelle. Une collection de masques mortuaires), paru pour la première fois en 1926 à Berlin. Enchanté, André Breton accuse réception de l'envoi le 5 février 1929 : « Mon cher Paul, j'ai reçu avant-hier l'admirable livre dont tu m'avais parlé (Swift, Hegel, l'Inconnue de la Seine). Merci de tout mon cœur. »
3.
Berlin, automne 1831. Depuis treize ans, Hegel est professeur à la Friedrich-Wilhelms-Universität, qui porte aujourd'hui le nom des frères Humboldt. C'est le couronnement d'une carrière académique qui l'a mené successivement de Tübingen, où il a fait ses études, à Iéna, Heidelberg et enfin à Berlin où il est nommé, à quarante-huit ans, à la chaire prestigieuse de philosophie, auparavant occupée par Johann Gottlieb Fichte. Sa renommée lui attire désormais de nombreux étudiants, en dépit de ses piètres qualités d'orateur. L'un de ses disciples, Heinrich Gustav Hotho, qui participera plus tard à l'édition posthume des œuvres complètes en éditant ses Leçons sur l'esthétique, se souvient de la rencontre avec le maître : « Je n'oublierai jamais la première impression donnée par son visage. Tous ses traits, pâles et mous, pendaient comme s'ils étaient morts ; ils ne reflétaient aucune passion dévastatrice, mais tout le passé d'une pensée silencieusement active nuit et jour. [...] Quelle dignité dans cette tête, quelle noblesse dans ce nez, dans ce front haut et voûté, dans ce menton calme. » En revanche, Hotho apprécie moins la façon dont Hegel donne ses cours : « Épuisé, la mine morose, il se tenait assis la tête baissée, replié sur lui-même, feuilletant constamment ses cahiers tout en discourant, cherchant sans arrêt, dans un sens puis dans l'autre, de haut en bas. » En 1829, Hegel devint cependant recteur de l'université, pour une année, comme c'était l'usage.
Le masque de Hegel, Thomas Hunkeler, Seuil, Collection Fiction & Cie, 2025.
Vous pouvez suivre le podcast de ces lectures versatiles sur les différents points d'accès ci-dessous :
RSS | Apple Podcast | Youtube | Deezer | Spotify
 View all episodes
View all episodes


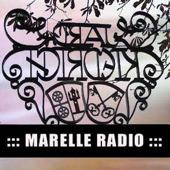 By Pierre Ménard
By Pierre Ménard
Thomas Hunkeler mène une enquête littéraire et historique sur le masque mortuaire du philosophe allemand qui est conservé aux Archives littéraires allemandes de Marbach, près de Stuttgart. À partir d'une lettre d'André Breton à Paul Éluard mentionnant son existence, il interroge son authenticité et sa signification. Thomas Hunkeler révèle la fascination pour ces objets funéraires, tout en proposant une histoire parallèle du surréalisme. Entre mythe et réalité, ce masque s'avère trace du défunt aussi bien que projection de ceux qui l'observent. Dans cette mise en récit d'un essai, entre érudition et esprit d'investigation, Thomas Hunkeler éclaire un pan méconnu du rapport des avant-gardes à la mort et à l'héritage des figures intellectuelles, tout en s'attachant à montrer la « dimension collective de la poétique du masque mortuaire ».
Le masque de Hegel, Thomas Hunkeler, Seuil, Collection Fiction & Cie, 2025.
Sa face a quelque chose de brut, de brutal presque : l'impression première est celle d'une masse épaisse et lourde. À peine visibles, ses traits sont comme estompés, gommés, à l'exception de la bouche qui semble vouloir exprimer une certaine fermeté, tout comme la lourde mâchoire. Les yeux que l'on devine à peine sont fermés, comme s'ils avaient sombré dans la masse du visage, sous les cernes ; seuls les sourcils, broussailleux, et le nez parfaitement droit donnent du relief à la figure. Le front, haut, porte la trace de quelques rares mèches de cheveux qui ressemblent étrangement à des rides verticales. Il y a quelque chose de fruste et de mal dégrossi dans cette figure. En allemand, j'utiliserais à ce propos le terme grobschlächtig, qui fait résonner, à côté de la notion de grossièreté, celle de schlagen, « battre », mais sous une forme désuète, schlächtig, que l'on retrouve de nos jours surtout dans l'appellation de celui qui abat les bêtes, le Schlachter. Serait-ce la face d'un boucher ?
2.
C'est en parcourant la correspondance d'André Breton et Paul Éluard que j'ai découvert l'existence du masque mortuaire de Hegel. On y apprend qu'en janvier 1929, au moment où il vient de repartir de Paris à Arosa, dans les Grisons suisses, pour soigner sa santé, Éluard s'arrête à Bâle, ville frontière, pour envoyer à Breton un ouvrage qu'il vient de découvrir dans une librairie le « Totenmasken », comme il l'écrit. Il s'agit du livre de l'historien de l'art allemand Ernst Benkard, Das ewige Antlitz. Eine Sammlung von Totenmasken (La Face éternelle. Une collection de masques mortuaires), paru pour la première fois en 1926 à Berlin. Enchanté, André Breton accuse réception de l'envoi le 5 février 1929 : « Mon cher Paul, j'ai reçu avant-hier l'admirable livre dont tu m'avais parlé (Swift, Hegel, l'Inconnue de la Seine). Merci de tout mon cœur. »
3.
Berlin, automne 1831. Depuis treize ans, Hegel est professeur à la Friedrich-Wilhelms-Universität, qui porte aujourd'hui le nom des frères Humboldt. C'est le couronnement d'une carrière académique qui l'a mené successivement de Tübingen, où il a fait ses études, à Iéna, Heidelberg et enfin à Berlin où il est nommé, à quarante-huit ans, à la chaire prestigieuse de philosophie, auparavant occupée par Johann Gottlieb Fichte. Sa renommée lui attire désormais de nombreux étudiants, en dépit de ses piètres qualités d'orateur. L'un de ses disciples, Heinrich Gustav Hotho, qui participera plus tard à l'édition posthume des œuvres complètes en éditant ses Leçons sur l'esthétique, se souvient de la rencontre avec le maître : « Je n'oublierai jamais la première impression donnée par son visage. Tous ses traits, pâles et mous, pendaient comme s'ils étaient morts ; ils ne reflétaient aucune passion dévastatrice, mais tout le passé d'une pensée silencieusement active nuit et jour. [...] Quelle dignité dans cette tête, quelle noblesse dans ce nez, dans ce front haut et voûté, dans ce menton calme. » En revanche, Hotho apprécie moins la façon dont Hegel donne ses cours : « Épuisé, la mine morose, il se tenait assis la tête baissée, replié sur lui-même, feuilletant constamment ses cahiers tout en discourant, cherchant sans arrêt, dans un sens puis dans l'autre, de haut en bas. » En 1829, Hegel devint cependant recteur de l'université, pour une année, comme c'était l'usage.
Le masque de Hegel, Thomas Hunkeler, Seuil, Collection Fiction & Cie, 2025.
Vous pouvez suivre le podcast de ces lectures versatiles sur les différents points d'accès ci-dessous :
RSS | Apple Podcast | Youtube | Deezer | Spotify