
Sign up to save your podcasts
Or


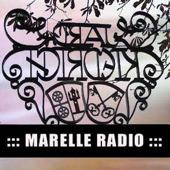

Dans Le passé à venir, l'anthropologue Tim Ingold nous invite à reconsidérer la notion de génération. Un processus continu au lieu d'une succession de strates temporelles. Il rejette par exemple la notion d'héritage qui ne peut pas être considérée comme un transfert statique de biens ou de connaissances, il lui préfère le concept de « perdurance ». Les vies humaines se tissent ensemble telles les torons d'une corde, garantissant ainsi la cohésion, la transmission et l'évolution. Tim Ingold ne soutient pas la conception moderne du progrès linéaire, il nous encourage plutôt à redonner de l'importance au vivant, à la coopération entre générations et à des formes de savoir qui perdurent dans le temps. Il prône une éducation axée sur le dialogue, et une nouvelle manière d'habiter le monde, plus sensible, plus humaine, plus durable.
Le passé à venir : Repenser l'idée de génération, Tim Ingold, traduit de l'anglais par Cyril Le Roy, Seuil, Collection La Couleur des idées, 2025.
Le sol stratifié
Lorsque j'ai commencé à enseigner à l'université, je me considérais en avance sur mon temps. Je ne me contentais pas de transmettre de nouvelles idées, j'utilisais les instruments les plus récents pour le faire. À l'époque, il n'y avait ni ordinateurs ni écrans numériques, et ce n'était que le début des photocopieuses. Cependant, mon département venait d'acquérir un « rétroprojecteur ». Si mes collègues plus âgés ne voulaient pas y toucher, j'en étais en revanche un fervent adepte. J'aimais inclure des diagrammes dans mes cours et je pouvais les préparer à l'avance en les dessinant sur des feuilles d'acétate, des « transparents ». L'appareil, composé d'une puissante source de lumière et d'un miroir incliné, permettait de projeter les dessins sur un grand écran, à la vue de tous. Je pouvais même écrire sur ces feuilles avec un feutre, soit avant, soit pendant que je parlais. La superposition des transparents sur la vitre produisait un effet particulier. À mesure que les diagrammes apparaissaient se dessinait à l'écran un enchevêtrement toujours plus touffu de lignes qui n'avaient pas plus de rapport entre elles que les trajectoires des gouttes de pluie ruisselant sur une fenêtre avec les textures du paysage visible au travers.
Les chemins du passé
À quoi cela revient-il de transformer ainsi la vie en héritage ? Cela équivaut à transformer des personnes en propriétés, des affects en effets, des foyers en maisons, des lieux en terrains et des conversations en textes. Dans tous les cas, il s'agit d'en extraire la vie, plutôt que de voir ces choses comme des nœuds de croissance et de développement continus. Par cette opération de réduction, la personne n'est plus qu'un ensemble de traits ou de caractéristiques, l'amour et le soin se résument à l'attribution de biens matériels, la maison n'est plus qu'un bâtiment, un lieu son cadre physique, la langue parlée un simple corpus d'expressions. Plus la vie est vidée des manières ancestrales, par leur conversion en héritage, plus elle se trouve écrasée sur le plan du présent. Nous avons déjà vu cette logique à l'œuvre dans le modèle généalogique, avec la séparation absolue qui est faite entre la vie qui se déroule au sein des générations et la transmission des ressources entre elles. Une fois de plus, nous retrouvons cette idée de générations empilées les unes sur les autres, chacune habitant sa propre tranche de temps, à la fois séparées et reliées par les transferts de l'héritage. Que se passe-t-il alors lorsque l'objet de la transmission est le sol même sur lequel la vie est vécue ?
Le passé à venir : Repenser l'idée de génération, Tim Ingold, traduit de l'anglais par Cyril Le Roy, Seuil, Collection La Couleur des idées, 2025.
Vous pouvez suivre le podcast de ces lectures versatiles sur les différents points d'accès ci-dessous :
RSS | Apple Podcast | Youtube | Deezer | Spotify
[1] Ces réflexions et celles qui suivent s'inspirent largement du récent ouvrage suivant : Danile Svensson, Katarina Saltzman et Sverker Sörlin (dir.), Pathways : Exploring the Routes of a Movement Heritage, Winwick (Cambridgeshire), White Horse Press, 2022.
[2] J'ai abordé plus longuement la formation du palimpseste dans un essai intitulé « Palimpsest : Ground and Page », paru dans Tim Ingold, Imaginig for Real : Essays on Creation, Attention and Correspondance, Londres, Routledge, 2022, p. 180-198.
 View all episodes
View all episodes


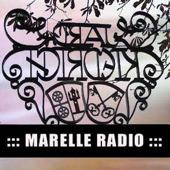 By Pierre Ménard
By Pierre Ménard
Dans Le passé à venir, l'anthropologue Tim Ingold nous invite à reconsidérer la notion de génération. Un processus continu au lieu d'une succession de strates temporelles. Il rejette par exemple la notion d'héritage qui ne peut pas être considérée comme un transfert statique de biens ou de connaissances, il lui préfère le concept de « perdurance ». Les vies humaines se tissent ensemble telles les torons d'une corde, garantissant ainsi la cohésion, la transmission et l'évolution. Tim Ingold ne soutient pas la conception moderne du progrès linéaire, il nous encourage plutôt à redonner de l'importance au vivant, à la coopération entre générations et à des formes de savoir qui perdurent dans le temps. Il prône une éducation axée sur le dialogue, et une nouvelle manière d'habiter le monde, plus sensible, plus humaine, plus durable.
Le passé à venir : Repenser l'idée de génération, Tim Ingold, traduit de l'anglais par Cyril Le Roy, Seuil, Collection La Couleur des idées, 2025.
Le sol stratifié
Lorsque j'ai commencé à enseigner à l'université, je me considérais en avance sur mon temps. Je ne me contentais pas de transmettre de nouvelles idées, j'utilisais les instruments les plus récents pour le faire. À l'époque, il n'y avait ni ordinateurs ni écrans numériques, et ce n'était que le début des photocopieuses. Cependant, mon département venait d'acquérir un « rétroprojecteur ». Si mes collègues plus âgés ne voulaient pas y toucher, j'en étais en revanche un fervent adepte. J'aimais inclure des diagrammes dans mes cours et je pouvais les préparer à l'avance en les dessinant sur des feuilles d'acétate, des « transparents ». L'appareil, composé d'une puissante source de lumière et d'un miroir incliné, permettait de projeter les dessins sur un grand écran, à la vue de tous. Je pouvais même écrire sur ces feuilles avec un feutre, soit avant, soit pendant que je parlais. La superposition des transparents sur la vitre produisait un effet particulier. À mesure que les diagrammes apparaissaient se dessinait à l'écran un enchevêtrement toujours plus touffu de lignes qui n'avaient pas plus de rapport entre elles que les trajectoires des gouttes de pluie ruisselant sur une fenêtre avec les textures du paysage visible au travers.
Les chemins du passé
À quoi cela revient-il de transformer ainsi la vie en héritage ? Cela équivaut à transformer des personnes en propriétés, des affects en effets, des foyers en maisons, des lieux en terrains et des conversations en textes. Dans tous les cas, il s'agit d'en extraire la vie, plutôt que de voir ces choses comme des nœuds de croissance et de développement continus. Par cette opération de réduction, la personne n'est plus qu'un ensemble de traits ou de caractéristiques, l'amour et le soin se résument à l'attribution de biens matériels, la maison n'est plus qu'un bâtiment, un lieu son cadre physique, la langue parlée un simple corpus d'expressions. Plus la vie est vidée des manières ancestrales, par leur conversion en héritage, plus elle se trouve écrasée sur le plan du présent. Nous avons déjà vu cette logique à l'œuvre dans le modèle généalogique, avec la séparation absolue qui est faite entre la vie qui se déroule au sein des générations et la transmission des ressources entre elles. Une fois de plus, nous retrouvons cette idée de générations empilées les unes sur les autres, chacune habitant sa propre tranche de temps, à la fois séparées et reliées par les transferts de l'héritage. Que se passe-t-il alors lorsque l'objet de la transmission est le sol même sur lequel la vie est vécue ?
Le passé à venir : Repenser l'idée de génération, Tim Ingold, traduit de l'anglais par Cyril Le Roy, Seuil, Collection La Couleur des idées, 2025.
Vous pouvez suivre le podcast de ces lectures versatiles sur les différents points d'accès ci-dessous :
RSS | Apple Podcast | Youtube | Deezer | Spotify
[1] Ces réflexions et celles qui suivent s'inspirent largement du récent ouvrage suivant : Danile Svensson, Katarina Saltzman et Sverker Sörlin (dir.), Pathways : Exploring the Routes of a Movement Heritage, Winwick (Cambridgeshire), White Horse Press, 2022.
[2] J'ai abordé plus longuement la formation du palimpseste dans un essai intitulé « Palimpsest : Ground and Page », paru dans Tim Ingold, Imaginig for Real : Essays on Creation, Attention and Correspondance, Londres, Routledge, 2022, p. 180-198.