Dans son premier roman, Clothilde Salelles nous plonge dans le quotidien d'une famille des années 90, en banlieue parisienne. À travers les yeux d'une enfant, on découvre un univers où le silence est pesant, les nuits troublées, et le père, reclus dans son bureau ou absent, une figure aussi fascinante qu'insaisissable. Les mots eux-mêmes deviennent des énigmes, entre ce qui est dit et ce qui reste tabou. Avec une écriture mêlant poésie et suggestion, l'autrice explore, avec une acuité presque fantastique, la mémoire, les non-dits, et l'impact du langage sur nos vies. Le récit s'articule autour d'un drame central, évoqué mais jamais nommé. Un roman sensible et troublant sur les liens familiaux et la manière dont on se construit face à l'absence et aux silences.
Nos insomnies, Clothilde Salelles, Collection L'arbalète, Gallimard, 2025.
Extrait du texte à écouter sur Spotify
Les journédificil condensaient des ciels oragés, ponctués d'esclandres qui explosaient aux horaires liminaires — le matin avant d'aller à l'école, le soir avant le coucher. S'il était rare que je comprenne la matrice de ces journées, elles étaient érodées par certains mots, des mots prosaïques, sans saveur, désignant des réalités froides, par exemple : périphérique, N20. Ou administratif, inspection, lotissement. Le contraste était flagrant entre la platitude apparente de ces mots (surtout en comparaison avec le connard qui sévissait au sein du foyer de Julie) et les remous qu'ils suscitaient chez les parents.
Périphérique et N20 : ces deux leitmotivs entouraient de stress les trajets des parents jusqu'à la capitale — quand le père avait des réunions, pour des rendez-vous professionnels, ou quand ils étaient invités chez d'anciennes connaissances parisiennes. Il était alors curieux de les voir s'éterniser dans le couloir d'entrée, ma mère avec les yeux cerclés d'eye-liner et des boucles d'oreilles, mon père délaissant son gros gilet marron pour un pull à col roulé qui lui donnait un drôle d'air. J'exultais à l'idée d'une soirée seule avec les jumeaux à dîner de bols de Miel Pops et de Frosties devant l'écran bombé de la télévision.
Le
périphérique, la N20 et surtout les
bouchons qui s'accumulaient dessus mettaient les parents
en retard : c'était ça qui était grave, être en retard était désastreux, être en retard était dramatique, ça nous compromettait auprès de ceux qui nous attendaient, ça provoquait leur colère. J'étais persuadée que le périphérique et la N20 n'y étaient pour rien, car j'étais moi-même tout le temps en retard, il semblait s'agir d'un problème héréditaire.
Le plus redoutable de ces mots était celui, inesthétique, de lotissement. Ils parlaient du lotissement d'à côté. Je ne comprenais pas pourquoi ce mot ricochait entre leurs lèvres, pour l'instant il n'y avait pas de lotissement autour de la maison mais un champ qui s'étalait jusqu'à la forêt en face, un hameau d'un côté et la départementale de l'autre, un champ safrané, couvert dès le printemps d'épis de blé rondement sculptés, avec pour seul résident Dédé, un âne que je nourrissais le matin quand je n'allais pas à l'école, sa grosse bouche molle ingurgitant à toute allure les carottes que je lui tendais.
En fait, le mot lotissement était une menace, associé à un archipel d'autres mots : autorisation, mairie, parcelle, permis de construire, et celui, incompréhensible, de péhèlhu (j'avais fini par comprendre qu'il s'agissait d'un sigle, PLU, mais je ne parvenais pas à mémoriser la signification de chacune de ces lettres). Ils charriaient des visions effrayantes : celles de maisons aux murs en crépi beige ou blanc, à la toiture en tuiles grises ou rouges, aux volets symétriques, avec leurs lopins d'herbe séparés par des palissades lasurées, les voitures familiales garées le long de la façade. Comme ces lotissements qu'on voyait dans les communes alentour de Breuillet ou de Saint-Chéron. Et pire que les maisons, ce qui était redouté, c'étaient les gens qui allaient y vivre : car il fallait être « sacrément gratiné » pour venir s'installer là, soutenait le père. Le lotissement annonçait la disparition d'un monde et l'avènement d'un autre.
L'avènement d'un monde régi par un autre mot, celui de promiscuité : on m'avait expliqué que cela renvoyait au fait d'être trop proche de ses voisins, de pouvoir observer et écouter leurs moindres faits et gestes, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus, ce mot dégageait une forme de vulgarité.
De fâcheux auspices prophétisaient cette dystopie. D'abord, l'âne disparut, je ne sus jamais ce qu'il advint de lui (les adultes voulurent me rassurer en me disant qu'on l'avait « emmené dans un champ plus grand », paroles qui me laissèrent dubitative car la taille de ce champ me semblait fort correcte sachant qu'il y résidait seul) ; puis le chemin de terre qui reliait la départementale à notre maison fut goudronné par de gros camions à citerne, il ressemblait désormais à une route.
Le soir, les parents étaient plongés dans leurs conversations d'adultes, je les entendais murmurer, attendant que le couperet de la décision de la mairie tombe ; ce n'était jamais clair, on avançait vers cette dernière sans qu'elle soit gravée dans le marbre, sentence continuellement prorogée.
Planait aussi une autre menace, venant du ciel, celle d'une intensification massive du trafic du couloir aérien, rumeur qui déferlait par vagues et se propageait sur l'ensemble de la région. Voir cette inquiétude reflétée dans les voix et les regards, dans des souffles protestataires - tracts distribués devant la mairie, rassemblements le samedi après-midi -, bref, voir cette inquiétude exister en dehors de l'enceinte de la maison avait quelque chose de rassurant, donnant à ce village d'ordinaire si confiné les apparences d'une communauté.
Moi, secrètement, j'aimais ces avions, ces lames ouvrant des portes secrètes sur les cinq continents : les voyages envahissaient notre ciel.
Sous l'abribus, le soleil du matin répandant des grains de poussière qui flottaient entre nous, les bavardages avec mes camarades étaient interrompus par ces bruits atmosphériques qui semblaient venir à la fois de très loin et de l'intérieur de nos corps. Ces sabres déchiraient le tissu du ciel en continu : chaque fois que l'un disparaissait dans un amas de nuages, un nouveau fendait déjà la piste azurée.
Marion étant la seule de la classe à avoir déjà pris l'avion, la seule à savoir à quoi ils ressemblaient à l'intérieur, elle fut promue au rang d'experte ; elle approchait son pouce de son index et avançait une estimation de la taille des engins avec une pointe de fierté dans la voix.
Mais ils ne se mesuraient pas, c'étaient des bouts de rêve.
Des bouts de rêve qui, dans la bouche du père, se métastasèrent en foutusavions.
*
Le père ne ressentait pas les bruits de la même manière que nous : ceux-ci s'infiltraient dans son corps comme un chancre, formant une barrière entre lui et le reste du monde.
Son hypersensibilité se cristallisait sur des sons en particulier : la radio de notre unique voisin, le sifflement de la départementale, les avions du couloir aérien, et pire, les bruits de travaux de ce voisin. Celui-ci était engagé dans un cycle perpétuel d'activités manuelles : cognements secs et plus ou moins réguliers du marteau, sifflements de la perceuse, cris métalliques de la disqueuse, vibrations et bourdonnements d'une panoplie d'engins motorisés. Un cycle inventif : terrasses, escaliers, mur de soutènement, bassin, murets et allées, dépendance, et - alors qu'il semblait avoir épuisé toutes ses possibilités - abri servant à contenir ses engins motorisés... Un Sisyphe des temps modernes.
À l'écoute de tous ces bruits, quelque chose se recroquevillait dans le père, ils avaient un effet patent sur son corps, ainsi laradioduvoisin et samusiquedebeauf éteignaient son regard, cesfoutusavions lui râclaient le crâne, ladépartmentale compressait ses épaules et sa nuque, et le paroxysme, c'étaient les bruitsd'travaux qui grouillaient dans tout son corps, le clouant définitivement au lit.
Le père était donc atteint d'une désynchronisation des sens : si les objets passaient à travers ses mains, les sons s'imprimaient sur sa peau, l'affectaient dans sa chair, se tapissaient sous l'occiput. Il était un être synesthésique. Ou bien peut-être était-ce nous qui avions développé une forme d'invincibilité ?
Si-lence était un mot angélique, le plus beau de la langue française, une bénédiction. Cette première syllabe sifflante, laissant les suivantes s'installer dans la bouche avec onctuosité. Nous ne prononcions pas ce mot, il était immanent : quand le silence régnait, il convenait de l'honorer en se taisant.
Certains bruits avaient toutefois la noblesse du silence : ainsi en était-il de l'aboiement de la chienne, du hurlement des malamutes, ces chiens-loups élevés par le couple qui vivait à l'entrée du chemin, des trilles des oiseaux aux aurores, du frémissement du vent et des notes de la pluie lors des intempéries, des feux d'artifice du 14 Juillet. Au camping, l'arrière-plan sonore — clameurs, rires avinés, chansonnettes, clochette du marchand ambulant de glaces, pédaliers, sonnettes de vélo, moteurs en tout genre — ce n'étaient pas des bruits, c'étaient des sons, des sons bénis du même sacrement que le silence, des sons qui avaient toutes les faveurs du père. Les parents avaient d'ailleurs déclaré de façon énigmatique qu'au camping, « on ne sent pas la promiscuité ».
Les mauvais bruits, je les entendais par procuration : mon appréhension ne se focalisait pas sur leurs effets dans mes oreilles, mais bien sur le maldetête qu'ils provoquaient chez lui - il m'arrivait ainsi d'être prise de panique en entendant des bruitsd'travaux s'enclencher ; puis, si je réalisais que le père n'était pas dans les parages, les bruits s'évanouissaient, les palpitations disparaissaient.
Quand les insomnies, les mauvaises nouvelles, les bruits advenaient, il ne se passait rien : pas de cris, pas de disputes, pas d'esclandres...
Et pourtant, l'univers glissait.
L'air devenait plus épais, sa composition se frelatait dans une texture saumâtre ; l'heure basculait, elle se perdait dans un frisson crépusculaire ; la maison respirait avec difficulté, infusée de ce leitmotiv, cépénible, ne désignant rien mais englobant tout. Ma mère s'agitait, les jumeaux se taisaient, et moi, je me faisais toute petite, je rêvais de posséder le don d'invisibilité.
Les bruitsd'travaux, laradioduvoisin, les foutusavions, ladépartmentale : l'incidence énorme de ces faits prosaïques sur les adultes m'interrogeait. Sous leur dimension matérielle, ils semblaient receler autre chose, une vérité cachée qui m'échapperait et expliquerait le hiatus entre leur manifestation en apparence anodine et leurs séquelles profondes sur le père.
L'été, nous quittions tout ça, ainsi que le lotissementd'àcôté qui n'en finissait pas de ne pas être construit ; à vrai dire, c'était la terre ferme que nous quittions, nous lévitions, protégés dans une chrysalide qui flottait sous un soleil sans fin ; chrysalide dans laquelle nos repères étaient bouleversés, où les tracas du quotidien devenaient des vétilles. Face aux objets, le père se réincarnait : il prenait part au montage de la tente, il pliait et dépliait la table et les chaises, il faisait usage du réchaud qui nous servait de plaque de cuisson, il découpait la pastèque du midi... Surtout, il s'enthousiasmait pour les mêmes choses que nous : les cerfs-volants qu'on s'efforçait d'envoyer dans le ciel, les courses d'escargots sur la table en plastique, les bouées et les matelas pneumatiques (acteurs cardinaux de nos périples marins), les grosses vagues qui attisaient des ondes d'euphorie, la magie du bruit et de la fureur de l'écume déchaînée. C'était une quiétude ailée : les journées baignaient dans une brume de coton, une brume chargée de volutes de clameurs et des rires du petit matin —inauguré par les rais de lumière filtrant à travers la toile de tente —, jusqu'aux soirées vaporeuses sous un dôme de chuchotements.
C'était toutefois un cocon labile, dont les fils manquaient de se dénouer pour un rien, une fluctuation dans l'air, une météo louvoyante, un orage à l'approche, et la fine membrane cédait, nous faisant retomber à terre. Ce qui l'annonçait, c'était cette once d'irritation de retour dans le regard et la voix des parents ; et alors les journées, de leur état liquide, redevenaient une suite d'étapes à surmonter.
Il m'arrivait d'identifier la source du déchirement de la soie, de faire le lien avec un événement précis. C'était parfois un dérèglement matériel, une lézarde : la flamme du réchaud qui ne s'allumait pas, privant les parents du premier café qui faisait vibrer quelque chose à l'intérieur d'eux, un arceau de tente égaré, les croquettes de la chienne qui manquaient, une serviette oubliée à la plage, un maillot de bain introuvable. La voiture était une fautive régulière : une rayure rutilante sur la carrosserie, un crissement engendrant un arrêt paniqué le long de la route pour vérifier l'état des pneus, un réservoir d'essence bientôt vide sans station à proximité, un calage, voire le véhicule qui avait du mal à démarrer... Le père serinait en boucle
une plaie cette voiture et
cépénible, et le problème dévorait la journée. La menace du dérèglement du réel ne venait plus de l'extérieur, mais du micromonde créé ex nihilo entre nous cinq, le fauve, la tente et la Mazda.
Nos insomnies, Clothilde Salelles, Collection L'arbalète, Gallimard, 2025.
Vous pouvez suivre le podcast de ces lectures versatiles sur les différents points d'accès ci-dessous :
RSS | Apple Podcast | Youtube | Deezer | Spotify



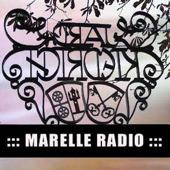

 View all episodes
View all episodes


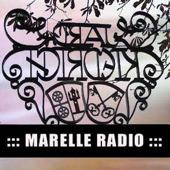 By Pierre Ménard
By Pierre Ménard