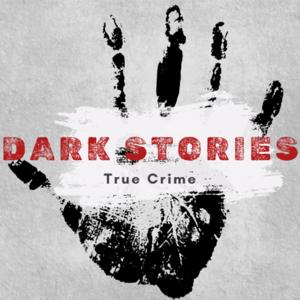Une vigile au Monument commémoratif de guerre du Canada après qu'un soldat montant la garde, le caporal Nathan Cirillo, a été tué le 22 octobre 2014 à Ottawa. Après avoir tiré sur le caporal, Michael Zehaf-Bibeau est entré au parlement où il a été abattu après une véritable chasse à l'homme. Photo : La Presse canadienne/Patrick Doyle
Qu’est-ce qui pousse des individus à commettre des actes terroristes au nom de croyances religieuses ou politiques?
Pourquoi des jeunes sont-ils happés par un discours djihadiste soit l’appel au combat pour conserver une terre d’Islam?
Michael Zehaf-Bibeau, auteur de l'attentat terroriste au Parlement à Ottawa. Photo: Presse Canadienne
Aurélie Campana, professeur de sciences politiques à l’Université Laval, explique les deux choses à retenir quant au djihadisme :
« Principalement il est né dans le contexte égyptien, mais pas uniquement, et est devenu un outil de contestation du pouvoir vu comme trop laïque et trop nationaliste […] Le djihadisme s’est imposé dans le contexte de la guerre d’Afghanistan 1979-1989 contre les Soviétiques […] mais également comme un outil de mobilisation de salafistes souhaitant combattre ce que beaucoup ont appelé des infidèles […] donc combattre pour conserver une terre d’Islam, c’est comme ça que la chose a été vendue. »
À la suite de ce conflit sont apparues plusieurs organisations comme Al Qaïda qui invitaient des combattants étrangers à s’enrôler.
Ismaël Habib, Montréalais de 29 ans, est le premier Canadien reconnu coupable d’avoir tenté de se joindre à un groupe terroriste à l’étranger. Photo : Facebook
D’autres organisations se sont ajoutées, et la croissance des réseaux sociaux a permis à des groupes comme Al Qaïda et Daech Daech (groupe armé État islamique) d’avoir une stratégie de communication.
« Ils ont mis en place des stratégies de propagande qui jouent à la fois sur la peur et la séduction pour convaincre directement ou indirectement un certain nombre d’individus d’adhérer à leur discours. » -Aurélie Campana
Aurélie Campana, professeur de sciences politiques à l’Université Laval Photo : Radio-Canada.
Ghayda Hassan . Photo : Radio-Canada.
Mais comment dépister les personnes à risque de se radicaliser?
Ghayda Hassan, chercheure clinicienne en psychologie à l’UQAM, cerne la problématique du dépistage :
« Pour faire du bon dépistage il ne faut pas en faire […] en ce moment les données probantes nous disent que les outils de dépistage se trompent dans la majorité des situations et elles causent des stigmatisations, des interventions musclées […] Et on sait très bien que des interventions policières qui n’ont pas lieu d’exister peuvent fragiliser ou pousser la personne plus rapidement dans la trajectoire en raison de l’injustice, de la colère que ça provoque, la stigmatisation. La meilleure façon de dépister c’est de rester à l’écoute de notre environnement, les enseignants, les professionnels dans différents milieux […] Et ça, c’est vraiment à la fois l’expérience clinique qui permet d’identifier les personnes à risque […] Et c’est un peu le modèle qu’on a créé ici qui existe déjà depuis un an, deux ans. »
Cette approche s’implante au Québec et ailleurs au Canada, mais n’est pas aussi présente dans d’autres pays qui adoptent davantage des structures de sécurité.
L’approche de prévention sera étudiée et documentée avec la nouvelle Chaire UNESCO sur la radicalisation à l'Université de Sherbrooke, Ghayda Hassan.
« La raison étant que particulièrement dans le domaine de la radicalisation violente, il y a tellement eu d’investissements dans des programmes qui n’ont jamais prouvé leur efficacité ou encore qu’il n’y a pas eu d’études qui dit que tel programme fonctionne dans tel contexte pour telle p...





 View all episodes
View all episodes


 By RCI | Français
By RCI | Français