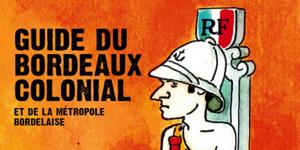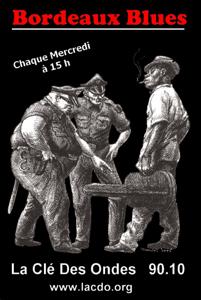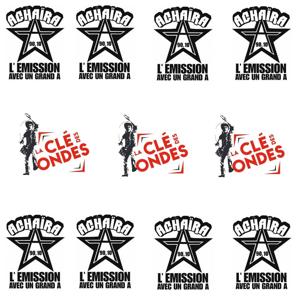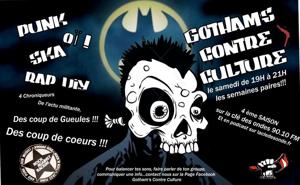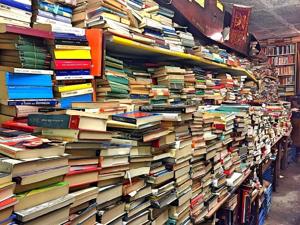« Attaquer la terre et le soleil » de Mathieu Belezi.
Résumé.
Au milieu du 19e siècle quelques familles comme celle de Séraphine, modestes et trompées par la propagande débarquent en Algérie où devaient les attendre terres arables et richesses programmées. En lieu et place, ils basculent dans un enfer de violence, entourés de
soldats terrifiants face à une population révoltée et attachée à l’indépendance de son pays.
Colonie de peuplement.
Nous sommes au moment où après avoir renoncé à l’esclavage la France devient un empire
colonial, remplaçant la traite négrière par le travail forcé, assujettissant et massacrant dans le
bruit et la fureur.
Par la force armée les conquêtes se multiplient et il faut aussi installer dans les pays colonisés des métropolitains qui seront les colons chargés d’introduire « la civilisation occidentale » à des « peuples barbares »...
Le personnage de Séraphine
Cette femme colon est arrivée depuis sa Lorraine natale (ces familles viennent essentiellement d’Alsace et de Lorraine) dans les années 1840 avec son mari, ses enfants, sa sœur et son beau-frère.Nulle idéologie chez cette femme, elle s’est contentée de suivre les conseils des autorités
françaises qui faisaient miroiter une terre vierge à exploiter.
Le roman raconte à deux voix : celles de Séraphine dont la parole fonctionne comme une complainte, une litanie, et de ce soldat, au discours violent et sans trace d’humanité. Un récit très réaliste, très minimaliste, pas d’épopée, pas de héros, pas de rebondissements spectaculaires, pas de sentimentalisme : des faits crus et cruels, des réalités terribles et implacables :
Une expérience de lecture.
C’est un texte quasiment sans ponctuation, qui est scandé comme un cri : un récit litanique aux longs couplets, d’une tristesse infinie, un chant de l'absurde et de la sauvagerie humaine. Le récit est rédigé en courts chapitres avec de fréquents retours à la ligne sans majuscules, comme des vers libres, ce qui lui donne un effet d'oralité.
Un roman violent et implacablement pessimiste.
Le lecteur attend en vain un sursaut, de l’apaisement, du calme : il est possédé par cette
forme d’écriture qui transcende le contenu mais il n’y a en fait aucun espoir, aucune échappatoire, aucun salut. Chaque personne est condamnée à la désillusion.
Comme le soldat croyant être présent pour participer à la «pacification» du pays, et qui en fait
assistera aux pires atrocités (enfumages et massacres de masse) et finira par y prendre part dans une sorte d’ivresse de la violence, sans même en comprendre le sens.
Comme les colons qui sont confrontés successivement à la rudesse du climat, aux terres difficiles, au choléra, aux fièvres et aux fauves.
L’auteur : Mathieu Belezi.
C’est un écrivain contemporain salué par la critique depuis vingt ans mais encore méconnu du
grand public. Il est né à Limoges en 1953, il y fait des études de géographie, puis enseigne en
Louisiane, vit successivement au Mexique, au Népal en Inde et maintenant en Italie. Il se
consacre à l’écriture à partir de 1999.
« Attaquer la terre et le soleil » renvoie à sa grande trilogie algérienne, publiée successivement aux éditions Albin Michel : « C’était notre terre », 2008 et Flammarion : « Les vieux
Fous », 2011 ; « Un faux pas dans la vie d'Emma Picard », 2015.
Le roman fait également écho à « Le Petit Roi », son premier roman publié en 1998 aux éditions
Phébus.
Le livre a reçu le Prix du Monde en 2022, le Prix du Livre Inter en 2023.
« L’âge de fer » de John Maxwell Coetzee
Résumé
Elisabeth Curren, femme blanche solitaire, se meurt d’un cancer au Cap, en 1986. Elle écrit
une longue lettre à sa fille, exilée au Etats-Unis. Elle y raconte son agonie, et les événements
tragiques entre émeutes et répression, d’un système qui tente de se maintenir : celui de
l’apartheid, Un clochard, sorte de témoin et confident, réfugié chez elle, l’accompagne.
Une dénonciation du système discriminatoire que constituait l’apartheid
Le récit est fortement inscrit dans la réalité par son cadre : Le Cap, les Townships, les 10 ans des révoltes de Soweto, les assassinats des membres de l’ANC par la police, et l’état d’urgence de 1986; par ses personnages : une femme blanche, un clochard noir, une femme de ménage noire, les jeunes noirs qui se révoltent et sont tués par la police ou par ce climat de violence et d’affrontement.
Une dénonciation plus implicite avec un autre récit parallèle qui agit comme une sorte de métaphore, voire d’allégorie.
Le texte, rédigé à la première personne, est celui d’Elisabeth Curren, qui écrit une longue lettre
posthume sa fille dont on sait qu’elle a fui l’Afrique de Sud et qu’elle n’y reviendra pas en raison
de son système politique et de la honte qu’il inspire, et dans laquelle elle évoque son sort intime
à savoir un cancer implacable qui la consume. Ainsi le cancer qui fatalement conduira à la mort
Elisabeth est mis en regard avec l’apartheid, qui de la même façon détruit dans la souffrance
également le pays, et le conduit à la mort.
Il est également un personnage entre réalité et métaphore, Monsieur Vercueil, clochard plutôt
rebutant qui rappelle un peu les clochards célestes de J.Kérouac, échoué dans le jardin
d’Elizabeth et qui deviendra au cours du récit, un confident, un soutien, une mémoire, un peu
comme un ange de la mort et chargé par Elizabeth de poster voire de porter sa lette
posthume...
Dimension prophétique
Ce roman à la langue précise et rythmée, dépouillée de sentimentalité mais non d'émotion,
contient une dimension prophétique car un an après sa parution l’apartheid établi en 1948, sera aboli : le 30 juin 1991 exactement.
L’apartheid est un mot afrikaans, qui signifie « séparation, mise à part ». Il désigne la politique
de « développement séparé » imposée, selon des critères raciaux ou ethniques, aux
populations d'Afrique du Sud. Plus largement, car il demeure encore dans certains endroits du
monde, on peut citer Israel à l’encontre du peuple palestinien par ex, c’est un système
d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre, institutionnalisé à travers des
lois, des politiques et des pratiques discriminatoires et qui suppose la commission d'actes
inhumains, dans l'intention de maintenir cette domination.
Littérature engagée
L’ensemble de l’œuvre de Coetzee est engagée, et utilise le même procédé : la juxtaposition de la réalité politique et de l’allégorie afin de mettre à jour les phobies et les névroses des individus, à la fois victimes et complices d'un système corrompu violent et servile qui anéantit son entendement voire même son langage.
On peut citer les romans célèbres tels que « En attendant les barbares » (1980), « Mikaël K, sa vie, son temps » (1983), « Foe » ( 1986), « Disgrace » ( 1999), ou « Elizabeth Costello » (2003).
Prix Nobel
Coetzee est né en 1940 au Cap dans une famille de boer calviniste ( colons afrikaners) . Il y vit sa jeunesse durant l’instauration violente de ce système de ségrégation de l’apartheid. Il part en Angleterre en 1060, pour y suivre des études de linguistiques et d’informatique avant de se consacrer à l’écriture et à l’enseignement universitaire de l’anglais. Il est aujourd’hui de nationalité australienne, pays où il vit.
Il a reçu de nombreux prix littéraires : il est le premier écrivain, à obtenir deux fois le prestigieux Prix Booker en 1983 et 1999 et surtout, il reçoit en 2003 la plus prestigieuse récompense internationale, le Prix Nobel de littérature.