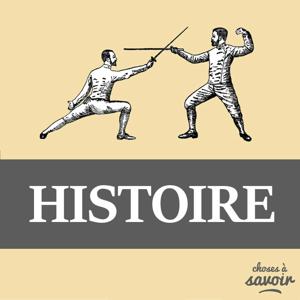Le bektachisme est l’une des confréries spirituelles les plus énigmatiques de l’histoire du monde musulman. Né entre mystique soufie, chiisme hétérodoxe et traditions populaires d’Anatolie, il a longtemps évolué à la marge de l’islam officiel, tout en jouant un rôle politique et culturel majeur dans l’Empire ottoman.
La confrérie tire son nom de Hacı Bektaş Veli, un mystique du XIIIᵉ siècle originaire d’Anatolie. Personnage semi-légendaire, il prêche une spiritualité fondée sur l’amour, la tolérance, l’égalité entre les êtres humains et la recherche intérieure plutôt que sur l’observance stricte de la loi religieuse. Dans un monde médiéval souvent dominé par l’orthodoxie, ce message tranche radicalement.
Le bektachisme se distingue d’abord par sa lecture symbolique et ésotérique de l’islam. Les textes sacrés ne sont pas rejetés, mais interprétés à plusieurs niveaux. Les rituels sont volontairement secrets, réservés aux initiés. Contrairement à l’islam sunnite classique, les bektachis ne mettent pas l’accent sur la prière canonique quotidienne, le jeûne strict ou la séparation rigide entre hommes et femmes. Le vin, normalement interdit, peut même avoir une valeur symbolique lors de certaines cérémonies.
Autre particularité majeure : le bektachisme accorde une place centrale à Ali, le gendre du prophète Mahomet, et aux douze imams du chiisme, tout en intégrant des éléments préislamiques, chrétiens et chamaniques. Cette hybridation religieuse a longtemps nourri sa réputation de doctrine “hérétique” aux yeux des autorités sunnites.
Son importance historique explose à partir du XVe siècle, lorsque la confrérie devient intimement liée aux janissaires, le corps d’élite de l’armée ottomane. Cette alliance offre au bektachisme une protection politique considérable. Pendant plusieurs siècles, la confrérie agit comme un contre-pouvoir spirituel, diffusant une vision plus égalitaire et plus souple de la religion au sein de l’Empire.
Mais cette proximité avec les janissaires scelle aussi son destin. En 1826, lorsque le sultan Mahmud II fait massacrer et dissoudre les janissaires, le bektachisme est à son tour interdit. Les tekkes, les lieux de rassemblement, sont fermés, les maîtres spirituels persécutés, et la confrérie entre dans la clandestinité.
Aujourd’hui, le bektachisme survit principalement dans les Balkans — notamment en Albanie — et en Turquie, sous une forme discrète. Plus qu’une simple confrérie religieuse, il incarne une autre voie de l’islam, profondément humaniste, où la quête spirituelle prime sur la loi, et où la foi se vit comme une expérience intérieure.
Le bektachisme reste ainsi un rappel troublant : l’histoire religieuse n’est jamais monolithique, et certaines traditions ont longtemps prospéré… précisément parce qu’elles refusaient les dogmes rigides.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.