
Sign up to save your podcasts
Or




L’information a pu en faire sourire certains, mercredi 30 juillet, qu’on a entendue notamment sur RFI : une vague de 1,30 a atteint les côtes du Japon, suite au séisme qui a frappé la péninsule russe du Kamtchatka, plus au nord.
1,3 mètre, pensez donc, c’est une vaguelette ! Eh bien non, nous explique Franck Lavigne du laboratoire de géographie physique, interrogé par Le Monde à Paris : « à partir d’un mètre, un tsunami est déjà considéré comme dangereux. Beaucoup de gens minimisent ce risque, en le comparant aux vagues de l’océan et en se disant, "un mètre, ce n’est rien, on peut plonger dessous et ressortir'. Mais un tsunami n’a rien à voir avec une vague à surfer. L’eau monte soudainement, et se déplace à très grande vitesse, et ne s’arrête pas. C’est comme un torrent dense, mais beaucoup plus rapide, explique encore le scientifique. Dès 30 à 50 centimètres d’eau en mouvement, il devient impossible de tenir debout. À un mètre, le courant peut emporter des personnes, renverser des véhicules, et même arracher les amarres des bateaux dans les ports. Le danger ne vient donc pas seulement de la hauteur, mais surtout de la vitesse et de l’énergie de l’eau déplacée. »
À lire aussiLe Japon lève l'avis de tsunami après le séisme en Russie
Plus de peur que de malLe séisme au large des côtes russes, de magnitude 8,8, l’un des six plus grands jamais enregistrés, a entraîné des tsunamis dans diverses régions du Pacifique : Russie, Japon, Hawaï, Polynésie française, Galápagos. « Avec des vagues parfois inférieures à 50 cm… mais qui peuvent donc provoquer des dégâts colossaux », insiste Le Figaro.
Toutefois, plus de peur que de mal. Il y a eu des dégâts, certes, surtout sur les côtes russes, mais on a évité la catastrophe. « Ce tremblement de terre, le plus puissant dans cette région depuis 73 ans, a fait monter très haut les craintes de voir une quinzaine de pays submergés », relate Le Monde. Mais « une à une, les alertes au tsunami ont été levées au fil de la journée d’hier, dans la plupart des nombreux pays qui bordent l’océan Pacifique. »
Le Washington Post s’interroge : « pourquoi l’un des plus grands tremblements de terre du monde n’a pas été suivi d’un tsunami monstrueux ». Réponse du journal : d’après un spécialiste russe, « l’une des explications possibles est l’absence de glissement de terrain important dans l’océan, qui aurait pu amplifier le tsunami. En effet, les mouvements sous-marins de sédiments ou de roches peuvent accroître l’énergie d’un tsunami jusqu’à 90 %. »
En l’occurrence, le séisme intervenu hier n’a pas provoqué de glissement de terrain important et donc pas n’a pas entraîné la formation de vagues géantes.
À lire aussiAlerte au tsunami dans le Pacifique après un puissant séisme au large des côtes russes
Donald Trump dans le déni du réchauffement climatiqueAutre phénomène climatique : le réchauffement. Avec cette décision annoncée hier par Donald Trump d’abroger le constat d’urgence climatique, établi en 2009 sous l’ère Obama par l’Agence américaine de protection de l’environnement. Un principe qui acte de manière formelle et scientifique la dangerosité des six principaux gaz à effet de serre et qui pose les bases de la lutte contre le changement climatique. Le président américain veut donc s’en débarrasser.
Commentaire de Libération à Paris : « le monde avait déjà compris que Donald Trump mettait tout en œuvre pour faire dérailler la lutte contre le réchauffement, minimisant ses conséquences présentes et futures, mais le Républicain vient de passer un cap, le dernier, celui du déni pur et simple de la réalité accablante et des preuves scientifiques du changement climatique. (…) Cette abrogation n’est rien de moins qu’une mise en pièces des fondations sur lesquelles repose tout l’arsenal réglementaire des États-Unis en matière de climat. »
Dans les colonnes du New York Times, Solomon Hsiang et Marshall Burke, deux climatologues de l’université de Stanford s’insurgent. « Trump veut vous faire croire que le changement climatique n’est pas dangereux. C’est faux. Nous savons, affirment-ils, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, que le changement climatique met en péril la santé et les moyens de subsistance de la plupart des Américains vivant aujourd’hui. (…) L’administration Trump affirme que le ralentissement des émissions de gaz à effet de serre nuit à l’économie et entrave le business, mais le réchauffement de la planète le fera bien davantage ».
À lire aussiÉtats-Unis: l'administration Trump veut revenir sur la régulation des émissions des véhicules
 View all episodes
View all episodes


 By RFI
By RFI




4.2
55 ratings

L’information a pu en faire sourire certains, mercredi 30 juillet, qu’on a entendue notamment sur RFI : une vague de 1,30 a atteint les côtes du Japon, suite au séisme qui a frappé la péninsule russe du Kamtchatka, plus au nord.
1,3 mètre, pensez donc, c’est une vaguelette ! Eh bien non, nous explique Franck Lavigne du laboratoire de géographie physique, interrogé par Le Monde à Paris : « à partir d’un mètre, un tsunami est déjà considéré comme dangereux. Beaucoup de gens minimisent ce risque, en le comparant aux vagues de l’océan et en se disant, "un mètre, ce n’est rien, on peut plonger dessous et ressortir'. Mais un tsunami n’a rien à voir avec une vague à surfer. L’eau monte soudainement, et se déplace à très grande vitesse, et ne s’arrête pas. C’est comme un torrent dense, mais beaucoup plus rapide, explique encore le scientifique. Dès 30 à 50 centimètres d’eau en mouvement, il devient impossible de tenir debout. À un mètre, le courant peut emporter des personnes, renverser des véhicules, et même arracher les amarres des bateaux dans les ports. Le danger ne vient donc pas seulement de la hauteur, mais surtout de la vitesse et de l’énergie de l’eau déplacée. »
À lire aussiLe Japon lève l'avis de tsunami après le séisme en Russie
Plus de peur que de malLe séisme au large des côtes russes, de magnitude 8,8, l’un des six plus grands jamais enregistrés, a entraîné des tsunamis dans diverses régions du Pacifique : Russie, Japon, Hawaï, Polynésie française, Galápagos. « Avec des vagues parfois inférieures à 50 cm… mais qui peuvent donc provoquer des dégâts colossaux », insiste Le Figaro.
Toutefois, plus de peur que de mal. Il y a eu des dégâts, certes, surtout sur les côtes russes, mais on a évité la catastrophe. « Ce tremblement de terre, le plus puissant dans cette région depuis 73 ans, a fait monter très haut les craintes de voir une quinzaine de pays submergés », relate Le Monde. Mais « une à une, les alertes au tsunami ont été levées au fil de la journée d’hier, dans la plupart des nombreux pays qui bordent l’océan Pacifique. »
Le Washington Post s’interroge : « pourquoi l’un des plus grands tremblements de terre du monde n’a pas été suivi d’un tsunami monstrueux ». Réponse du journal : d’après un spécialiste russe, « l’une des explications possibles est l’absence de glissement de terrain important dans l’océan, qui aurait pu amplifier le tsunami. En effet, les mouvements sous-marins de sédiments ou de roches peuvent accroître l’énergie d’un tsunami jusqu’à 90 %. »
En l’occurrence, le séisme intervenu hier n’a pas provoqué de glissement de terrain important et donc pas n’a pas entraîné la formation de vagues géantes.
À lire aussiAlerte au tsunami dans le Pacifique après un puissant séisme au large des côtes russes
Donald Trump dans le déni du réchauffement climatiqueAutre phénomène climatique : le réchauffement. Avec cette décision annoncée hier par Donald Trump d’abroger le constat d’urgence climatique, établi en 2009 sous l’ère Obama par l’Agence américaine de protection de l’environnement. Un principe qui acte de manière formelle et scientifique la dangerosité des six principaux gaz à effet de serre et qui pose les bases de la lutte contre le changement climatique. Le président américain veut donc s’en débarrasser.
Commentaire de Libération à Paris : « le monde avait déjà compris que Donald Trump mettait tout en œuvre pour faire dérailler la lutte contre le réchauffement, minimisant ses conséquences présentes et futures, mais le Républicain vient de passer un cap, le dernier, celui du déni pur et simple de la réalité accablante et des preuves scientifiques du changement climatique. (…) Cette abrogation n’est rien de moins qu’une mise en pièces des fondations sur lesquelles repose tout l’arsenal réglementaire des États-Unis en matière de climat. »
Dans les colonnes du New York Times, Solomon Hsiang et Marshall Burke, deux climatologues de l’université de Stanford s’insurgent. « Trump veut vous faire croire que le changement climatique n’est pas dangereux. C’est faux. Nous savons, affirment-ils, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, que le changement climatique met en péril la santé et les moyens de subsistance de la plupart des Américains vivant aujourd’hui. (…) L’administration Trump affirme que le ralentissement des émissions de gaz à effet de serre nuit à l’économie et entrave le business, mais le réchauffement de la planète le fera bien davantage ».
À lire aussiÉtats-Unis: l'administration Trump veut revenir sur la régulation des émissions des véhicules
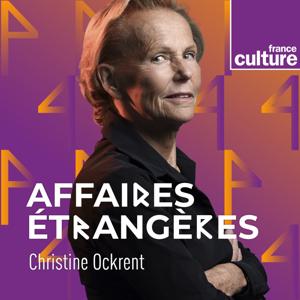
123 Listeners

14 Listeners

42 Listeners

190 Listeners

55 Listeners

14 Listeners

31 Listeners

35 Listeners
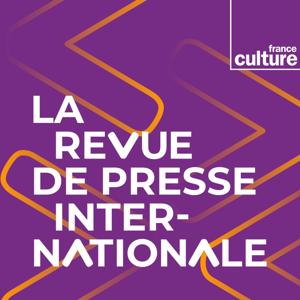
37 Listeners

11 Listeners

2 Listeners

40 Listeners

29 Listeners

4 Listeners

0 Listeners

15 Listeners

0 Listeners

24 Listeners

3 Listeners

3 Listeners

0 Listeners

30 Listeners

21 Listeners

0 Listeners

2 Listeners

4 Listeners

1 Listeners
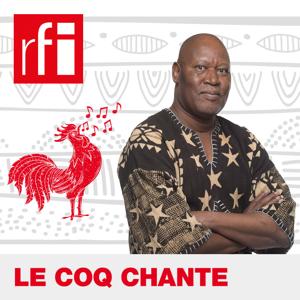
4 Listeners

0 Listeners

1 Listeners

49 Listeners

1 Listeners

0 Listeners

0 Listeners

0 Listeners