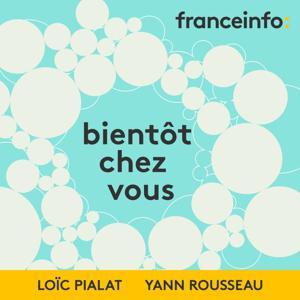Alexandre Helwani nous invite à percevoir le parfum comme une passerelle vers l’invisible, vers une mémoire olfactive de l’humanité. Son parcours, sa passion et sa créativité nous rappellent que derrière chaque senteur se cache une histoire, une culture, une mémoire et des recherches. Cet autodidacte devenu historien du parfum est capable de faire revivre des formules du passé. Il souhaite transmettre des sensations, des émotions, et rendre plus accessible l’art du parfum.
Je pense que la création, c'est d'être témoin de quelque chose. Ce n’est pas moi qui le dis, c'est Olivier Debré qui disait que créer, c'est être témoin d'un événement et en témoigner par notre art. J'aime cette capacité. C'est essentiel. Je ne pourrais pas vivre autrement. Aujourd'hui, c'est du parfum, mais il y a aussi de la poésie, de la musique. Chaque médium, permet d'accéder à une part de soi-même, à dire quelque chose qu'on ne pourrait pas dire autrement.
Alexandre Helwani, créateur de parfum.
« Il n'y a pas d'historien du parfum à proprement parler. Il y a des historiens du commerce, de l'alimentation, de la médecine et qui tous, à un moment, vont parler de parfum ou vont sortir des recettes parfumées sans pour autant s'y intéresser », rappelle-t-il.
Né à Orléans, Alexandre Helwani a grandi entre la France et Dubaï. Après des études de théâtre, de massage, un passage à la Sorbonne, il a parcouru différents chemins, sans jamais oublier sa passion pour l’olfaction.
« J'ai passé mon bac à 16 ans. De 16 à 26 ans, à peu près, j'étais dans l'errance totale. Tous mes amis, ma famille s'inquiétaient pour moi. Ils disaient : "Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Tu as fait du théâtre, tu as écrit des pièces, c'est super, tu as arrêté, tu fais des massages, tu arrêtes, tu fais du vin, tu arrêtes, tu fais de l'édition, tu arrêtes. À quel moment tu te poses ?" Et tous ces moments, cette longue attente, s'est cristallisée dans le parfum. J'ai appris à travailler des naturels quand j'avais 13 ans et que j'ai travaillé avec, parce que tous les parfums anciens, forcément tout ce qui est avant le XIXᵉ siècle, c'est 100 % naturel. Cela m'a appris à formuler en naturel et c'est arrivé au bon moment. En 2020, le consommateur et l'industrie se sont dit : "On aimerait bien avoir des parfums 100 % naturels qui sont autre chose qu'un mélange aroma-thérapeutique." Cela s'est fait graduellement. J'ai eu cette première marque, puis la deuxième, puis le projet Odyssée, et le parfum de la Bible, en ce moment. C'est une niche de la niche dans la niche, j'ai envie de dire, que j'ai un peu ouverte malgré moi et que j'occupe aujourd'hui. Je suis très content de l'occuper. Voilà, tout fleurit un peu comme cela », raconte-t-il.
L’intérêt pour les matières naturelles d’Alexandre Helwani s’est approfondi lors de ses voyages, notamment au souk de Dubaï, ainsi qu’à travers ses rencontres avec des artisans. Il connaît en détail l’encens, les résines, les huiles essentielles, bref les matières naturelles.
« Cela s'est construit depuis ce moment à Dubaï, puisque j'y avais rencontré un parfumeur indien qui faisait des zaatar, des parfums en huile typiquement utilisés en Inde, au Moyen-Orient. Je me souviens, quand j'y allais, et que je m'ennuyais un peu, j'entrais dans sa petite échoppe avec toutes ces matières premières, avec des noms qui étaient pour moi très exotiques : le vétiver, le henné, etc. Je sentais tout, je lui posais des questions sur tout. Il m'a un peu appris sur les matières naturelles, puisqu'il ne travaillait qu'avec du naturel, ce qui est assez rare aujourd'hui de travailler en 100 % naturel. Ma formation, j'ai envie de dire techniques sur les matières a commencé là, puis elle a continué de manière empirique. »
« À chaque fois que je trouvais une recette du XVᵉ siècle, du XIIIᵉ siècle, je la faisais à la maison. Cela a été empirique jusqu'à ce moment où je me suis dit : "Je vais consacrer toute mon énergie à la parfumerie !". J'ai lancé ce site (The Perfume Chronicles ) et puis six mois plus tard, il y a Virginie Roux, qui avait une marque de parfum et une galerie à Paris, qui me contacte. Elle avait aimé mon approche historique et un peu mystique, et elle me dit : "Est-ce que tu aimerais une exposition pendant trois mois autour des parfums orientaux ?" Alors je lui dis : "Il n'y a pas un Orient, il y en a plusieurs, mais allons-y." »
Retrouver des recettes anciennes, souvent oubliées ou méconnues, ayant traversé les siècles est une quête pour Alexandre Helwani. Avec patience et rigueur, il explore traités, thèses, livres anciens, manuscrits, archives archéologiques, pour comprendre les formes du parfum. Et en 2020, il donne naissance à sa première création. « Makeda, la reine de Saba, qui était éthiopienne, qui avait apporté tous ses parfums au roi Salomon. Je sais que c'est un bon point de départ pour un parfum. Moi, je n'avais jamais créé pour une marque commerciale, jusque-là, je pensais que c'était une blague totale. Puis deux mois après, il me rappelle et me dit : "Où est ton parfum ? Parce que j'ai reçu les soumissions de tout le monde sauf les tiennes." Je lui ai dit : "Oui, ça arrive, c’est en macération." J'appelle un autre ami pour m’aider à produire le parfum, je ne sais pas comment faire, je sais que je ne peux pas calculer le prix, je sais qu'il y a des contraintes réglementaires, etc. Il me faut un logiciel. Je ne sais absolument pas quoi faire. Il me répond : "Je te donne mon logiciel et on y va." Cela m'a permis de voir ce que c'était le travail de parfumeur, qui n'est pas juste être dans son laboratoire et puis de faire ses petits mélanges et on est content ! La première formule que j'avais faite pour ce parfum coûtait 8 000 € le kilo, ce qui est complètement exorbitant. C'est là où on travaille vraiment sur l'ordinateur, on travaille ses qualités, la réglementation cosmétique pour être sûr que le parfum soit dans les clous. C'est là que j'ai lancé mon premier parfum, en 2020, pour cette marque qui s'appelle Makeda, le parfum 100 % naturel. »
En expérimentant en laboratoire ou en atelier, Alexandre Helwani établit des liens concrets entre histoire, culture et olfaction. Il est alors en mesure de recréer des parfums comme le parfum de la Bible ou celui de l’Odyssée. « La plus grande difficulté dans un parfum historique, c'est de s'assurer de la matière. Parce qu'il y a 2 000 ans, le mot cannelle ne voulait pas nécessairement dire cannelle. D'autant plus qu'il y avait aussi chez certains parfumeurs de l'époque une volonté de cacher. On publiait une formule où on vous dit cannelle, alors que ce n'est pas du tout de la cannelle. Quand on parle de la Bible, le mot nard dans la Bible, à l'époque de l’écriture du Nouveau Testament, cela pouvait dire ce qu'on appelle le nard, aujourd'hui nard jatamansi, qui est une racine qu'on trouve dans l'Himalaya, mais cela pouvait aussi être une variété de lavande ou de la citronnelle. Il faut donc comprendre déjà de quelle matière on parle. Et pour faire ça, il faut se remettre dans le contexte d'écriture de l'époque. Après, de manière empirique, on va comparer et voir ce qui fait sens. En refaisant la recette, on comprend que non, ce n'était pas de la cannelle parce que j'ai senti un parfum qui en est très proche puisque les recettes étaient assez similaires et ça ne sentait pas ça, donc c'était autre chose. Il y a vraiment quelque chose d'empirique et d'historique. Il y a tout ce travail de botanique, d'histoire de la botanique et d'histoire de la pratique, tout simplement. »
« Mais la bascule, elle s'est vraiment faite, j'ai envie de dire, avec Makeda. C'était pour une marque qui s'appelle Parfumeurs du monde, qui est distribuée partout dans le monde, qui est chez Jovoy, l’une des plus grandes, belles parfumeries de Paris. Puis la deuxième bascule, c'était Tong Ren que j'ai fait pour cette petite maison qui s'appelle Elementals, pour lequel j’ai reçu un Art and Olfaction Award, on va dire un petit César du parfum. Moi, mon approche est toujours restée la même mais les projets sont devenus plus grands. Il y a eu le parfum de l'Odyssée juste après et ça a été mon plus beau projet, en termes de processus avec tout l'équipage. Un équipage de chanteurs, de poètes, d'artistes. Ils sont allés sur les traces du voyage d'Ulysse in situ. Sur chaque lieu de chaque chant pour récolter les graines des plantes qui sont mentionnées dans l'Odyssée. Il y avait une volonté de faire un jardin d'Odyssée et donc ils sont venus me voir. Ils m'ont raconté leur démarche et demandé de faire un parfum avec les 44 plantes de l'Odyssée. J’ai aussi mon travail de sourceur parce que j'ai des contacts un peu partout. Je connais aussi des sourceurs de matières premières, donc j'ai trouvé pour ce parfum un absolu de datte, ce qui n'est pas utilisé en parfumerie et notamment dans le chant pour Polyphème, on parlait de laine, alors ce n'est pas un végétal, mais c'est tout de même une odeur, puisque c'est le moment où Ulysse et son équipage se cachent sous les moutons pour passer sous le Cyclope. Et il se trouve que j'ai un ami qui avait déménagé en Écosse. Il a ouvert une bergerie. Je lui ai dit : "Est-ce que tu peux me faire un absolu de laine ?" Il me dit "Qu'est-ce que c'est ? J'ai répondu : "Je t'envoie de l'alcool, je te dis comment ça se passe et tu m'en fais." Et il m'en a fait. Je l'ai mis dans le parfum et cela a eu un gros retentissement dans la sphère du parfum et la sphère un peu littéraire. Ensuite, le parfum de la Bible avec l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Les projets sont devenus de plus en plus importants parce que je pense qu'il y a un intérêt sur l'histoire du parfum. »
Alexandre Helwani peut reconstituer un parfum de l’Antiquité ou du Moyen Âge, permettant ainsi de faire revivre des odeurs disparues, et d’offrir une expérience olfactive à la croisée de l’histoire et de l’artisanat. Mais son approche est sans pareille. « Mine de rien, cela fait dix-sept ans que je me consacre à l'étude, à la recréation de recettes anciennes, huit heures par jour. Je travaillais, puis le soir, vu que j'étais insomniaque, je passais mes nuits à étudier des traités de pharmacopée. J'appelais des profs pour me retraduire des tablettes anciennes pour être sûr de savoir de quelle matière il s’agissait. Dès que j'avais un peu d'argent de poche, ça allait dans le parfum. J'ai consacré, on va dire, quatorze ans de ma vie à ça. Et cette approche historique, c'est un travail de fond, c'est-à-dire que les historiens ne sont pas parfumeurs, les parfumeurs ne sont pas historiens. Il n'y en a aucun des deux qui est botaniste. Il faut quelqu'un qui puisse servir de pont. C'est ça qui me permet de pouvoir lire un texte comme la Bible et de trouver cette formule dans le Cantique des cantiques et de dire : "Je sais que c'est une formule parce que les matières de ce parfum vont trop bien ensemble pour avoir été posées là par hasard. C'est un travail de parfumeur, ça, c'est sûr, mais ça, je peux le dire parce que j'ai lu des formules antiques, parce que j'ai pesé des formules antiques et que je peux dire, oui, en fait, quand il y a de la grenade, je sais que c'est de la grenade qui est cuite, que ça c'est un parfum qui était liquide. Parce que ça me rappelle des formules que j'ai refaites". »
« Premièrement parce que j'ai travaillé sur des livres comme l'Odyssée ou autre, ou des recettes un peu symboliques. Il y a plein de traités magiques du Moyen-Âge qui avaient des formules de parfums. Et là, je vois cette formule et je me dis : " Mais ça me rappelle des formules contemporaines de l'écriture de ce texte !" Ça a l'air d'être une formule de parfum. Tout va trop bien ensemble. C'est une formule de parfum. Une formule, c'est des chiffres. C'est un texte hébraïque. Je contacte un rabbin et c'est comme ça que, au bout de trois ans de travail, on découvre qu'il y avait une formule cachée dans le texte. Je la refais et ça sent bon. Je pense que le fait que j'aie un parcours justement éclectique, en plus l'expérience avec les matières naturelles. Et ce temps à manger ces formules, à les mâcher et à les laisser pénétrer par leur matière. Je pense que cette approche-là, elle est unique. »
L’industrie du parfum est un secteur hermétique où la transparence et la reconnaissance des créateurs restent limitées, selon Alexandre Helwani. Son savoir empirique lui a permis d’y avoir sa place sans être parfumeur de formation. « C'est une industrie qui est très hermétique, donc y entrer, ça n'a pas été facile. Après, c'est vrai que mon angle, ça n'a jamais été de vouloir être parfumeur ou travailler dans cette industrie. Je me suis juste dit : "Je vais au moins partager ce que j'ai découvert et que je connais sur l'histoire des matières et que je sais être juste et vrai et pas continuer de perpétuer des mensonges, etc." À cette ère du numérique, on a accès à des ressources assez formidables. Il suffit de vouloir et de savoir où chercher. Cela demande beaucoup de persévérance. C'est vrai que quand j'ai commencé ma méthode, c'était dès que je lisais un brief de parfum, ou que j'écoutais un parfumeur parler, ou que je lisais une matière que je ne connaissais pas, j'allais l'acheter. À l'époque, il y avait quelques sites qui revendaient les matières premières en petites quantités. Qui venaient tous de Californie. Ça coûtait des fortunes. Je me souviens de dire à des amis que je ne pouvais pas aller boire des verres avec eux, parce que je venais de commander trois grammes d'iris et que c'était super important. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus facile d'entrer dans cette industrie qui commence tout de même à s'ouvrir. Il y a un besoin de transparence de la part du consommateur. Il y a une mise en avant des parfumeurs, donc ça commence à se démocratiser, à s'ouvrir. »
Pour Alexandre Helwani, le parfum est une expression poétique, une manière de témoigner de notre humanité. « Mais mon Dieu, si seulement on pouvait être plus sensibles au Parfum ! Avec un grand P. Et se dire que ce n’est pas juste quelque chose qu'on achète pour sentir bon, ça va bien plus loin. Ça fait plus de 15 000 ans qu'on fait du parfum. 15 000 ans qu'on brûle des choses parce qu'elles sentent bon. 15 000 ans qu'il y a des gens qui se sont dit : "mais cet arbre, on ne va pas le brûler, alors qu'on en a besoin parce qu'il fait froid, mais on va le garder parce que sa sève sent très bon". Et là, il y a un mystère de l'humanité qui se déploie et que je ne peux pas expliquer. Et de voir toutes ces formes anciennes et de voir cette même fascination, cette même recherche que je vis. Parce que cette incapacité à laquelle je suis confronté. Je pense que Tapputi Belet-ekalle qui est la première parfumeuse citée dans l'histoire, elle l'a vécu aussi avant de mettre sa formule sur le papier. Elle aussi s'est dit : "Non ce n’est pas ça, non ce n’est pas ça". On a une expérience qui est pareille et là en le sentant on peut se dire : "Je sais ce que tu ressens, je ne te connais pas, je ne pourrai jamais entendre ta voix, je ne pourrai jamais me concevoir ton visage. Mais là, ce que je sens, ce que mon corps sent, toi aussi, tu l'as ressenti il y a 4 000 ans". Et le parfum, c'est cela. Le parfum, c'est vraiment une manière de se rendre au monde. »
Selon Alexandre Helwani, le parfum est une porte vers l’invisible, un langage symbolique capable de transmettre des émotions, des souvenirs ou des messages spirituels, une expérience sensorielle reliant passé et présent. « C'est une autre forme de perception du monde. La beauté du parfum, c'est que ça ouvre une porte d'appréciation du monde qui est assez folle. Quand vous vous baladez, une fois qu'on connaît les molécules, qu'on a appris à les reconnaître, on les sent partout. C'est incroyable d'avoir une immédiateté au monde, de se dire : "Il est minuit et demi, il y a la glycine du voisin qui vient de fleurir. Je ne la vois pas, mais je la sens." Ce que j'essaie de faire, dans le parfum, c'est de le sortir de son flacon. Inventer une nouvelle forme du parfum. La beauté du mot parfum, c'est que le parfum ne désigne pas le contenu parfum per fumum, par la fumée, donc ça désignait ce qui restait après que l'encens a été consumé. Chez les Égyptiens et dans beaucoup de religions antiques, le parfum était un moyen de nous mettre en présence de l'invisible. On faisait ces sacrifices aux idoles, aux dieux. Le prêtre consomme tout et on rentre dans le temple 4,5 ou 6 heures après, on n'a plus rien, on n'a plus ces sacrifices, mais on a encore une odeur. C'est bien qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas voir, toucher, entendre, ressentir. Mais en tout cas, quelque chose est là qui nous dépasse. Et cela, c'est le parfum. C'est un mot qui désigne ce qu'il fait advenir. Quand je prends un flacon de parfum et que je mets du parfum, je me mets en présence ou je mets quelqu'un en présence d'autre chose. »
Abonnez-vous à « 100% création »
«100% création » est disponible à l’écoute sur toutes les plateformes de podcasts : PURE RADIO, Apple Podcast Castbox Deezer Google Podcast Podcast Addict Spotify ou toute autre plateforme via le flux RSS.
Si vous aimez ce podcast, donnez-lui 5 étoiles et postez un commentaire sur ces applications pour qu'il soit visible et donc encore plus écouté
Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux : Instagram 100% Création Facebook 100% Création-RFI