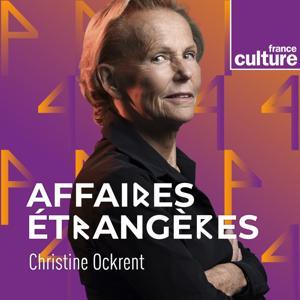Le cacao du premier producteur mondial est-il commercialisé à un prix trop élevé ? Aux yeux de certains opérateurs, il n'est, en tout cas, pas compétitif sur le marché mondial.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cours du cacao à la Bourse de Londres, à un instant T, est le même pour tous les pays producteurs. Mais ensuite viennent se greffer à ce prix une décote ou une prime, selon la qualité du cacao et son pays d'origine, pour schématiser. Actuellement, par exemple, cette prime est de 125 livres par tonne sur le cacao ivoirien, alors que le cacao camerounais est vendu avec une décote de 100 à 200 livres par tonne, et le nigérian avec une décote de 300 à 400 livres par tonne, ce qui contribue à rendre ces origines plus attractives.
À cette prime d'origine — appelée aussi prime pays –, il faut ajouter, pour acheter du cacao de Côte d'Ivoire et du Ghana, une prime fixe : le différentiel de revenu décent, ou DRD — LID en anglais —, de 400 dollars la tonne. Cette prime vise à protéger le cacaoculteur ivoirien contre des prix trop bas. Mais elle rend aussi le cacao ivoirien moins compétitif.
À lire aussiCôte d’Ivoire: le gouvernement compte racheter les stocks de cacao qui s'entassent
Le cacao ivoirien incontournable
Les acheteurs peuvent cependant difficilement se passer des fèves de Côte d'Ivoire, car le pays représente 40 % de la production mondiale. Mais les multinationales peuvent, en revanche, temporairement choisir de faire tourner en priorité leurs usines de broyage situées en Europe ou en Asie, qui peuvent être alimentées par toutes les origines, contrairement aux usines ivoiriennes. Et c'est ce que certaines disent faire aujourd'hui.
Pour que les industriels privilégient à nouveau l'achat de contrats cacao en Côte d'Ivoire, il faudrait que les fèves redeviennent compétitives. Concrètement, cela pourrait passer par un abaissement de la prime sur l'origine ivoirienne, qui est une composante du prix final. Une éventualité qui ne séduit pas, pour l'heure, le Conseil du Café-Cacao (CCC), le régulateur de la filière.
À lire aussiCôte d'Ivoire: le Conseil du Café Cacao à la rescousse de la filière cacao
Le DRD en question
Certains opérateurs interrogent aussi l'existence et le niveau du DRD, cette prime structurelle destinée à protéger le planteur. « 400 dollars la tonne, c'est trop cher », explique un broyeur de fèves, car comme cette prime est fixe, elle paraît encore plus importante quand les cours baissent.
Mais ces industriels sont dans une position compliquée car ils ont validé le principe de la prime en 2019 pour améliorer le revenu des planteurs. « Revenir sur leur engagement reviendrait à se soustraire à leurs responsabilités », fait comprendre un interlocuteur du CCC.
Le secrétariat de l'Initiative cacao Côte d’Ivoire-Ghana rappelle, de son côté, que le différentiel de revenu décent est un mécanisme de soutien au producteur décidé conjointement entre les deux États d'Afrique de l'Ouest et assure ne pas être informé d’une quelconque remise en cause du DRD.
À lire aussiEn Côte d’Ivoire, le désarroi des planteurs de cacao face aux impayés