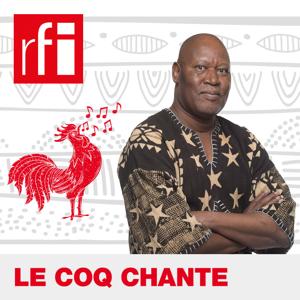Six tirailleurs africains dont quatre Sénégalais, un Ivoirien et un soldat issu de la Haute-Volta (devenu Burkina Faso) viennent officiellement d'être reconnus « morts pour la France . Tous ont été exécutés sur ordre d'officiers de l'armée française au camp de Thiaroye, au Sénégal en 1944. Retour sur une décision mémorielle inédite avec Aïssata Seck, présidente de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais et directrice de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage.
RFI : Quel est le poids de cette reconnaissance par les autorités françaises dans ce dossier ?
Aïssata Seck : Cette reconnaissance est un choix extrêmement important aujourd’hui, car c’est une demande qui avait été faite depuis des années par les descendants de ces personnes qui ont été massacrées à Thiaroye en 1944. C’est donc à mon sens un choix cohérent qui permet de regarder en face une page très douloureuse de l’histoire franco-sénégalaise, et qui permettra bien évidemment d’ouvrir d’autres dossiers, notamment la question du bilan officiel de 35 morts qui avait été annoncé à l’époque par l’État français.
Six tirailleurs reconnus morts pour la France à titre posthume. Mais qu’en est-il des autres ? Pourquoi aussi peu ? L’identification prend du temps ?
L’identification prend du temps. Il faut à nouveau regarder les archives, en tout cas une partie des archives qui avaient été remises en 2014 par le président François Hollande. Et regarder aussi le travail des chercheurs et des historiens qui ont travaillé dessus depuis des années. À mon sens, il faudrait que l’on puisse permettre les fouilles des fosses communes, car d’après les recherches qui ont été faites, un certain nombre d’entre eux ont été jetés dans des fosses communes. Et si on veut aujourd’hui avoir un bilan officiel et proche de la réalité, il faudrait qu’on puisse permettre cela.
Le travail de recherche doit donc se poursuivre ?
Le travail de recherche doit donc se poursuivre. La mention « morts pour la France » est une avancée extrêmement importante, parce que d’autres présidents jusque-là n’avaient pas accordé cette mention « morts pour la France ». Aujourd’hui, on est dans une avancée historique et majeure. Néanmoins, il faut que l’on puisse continuer ce travail. Un travail qui permettra, comme je l’ai dit, une identification, mais qui permettra aussi d’avancer sur le travail de mémoire entre la France et le Sénégal, sur une histoire extrêmement tragique et douloureuse qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ce travail de mémoire passe aussi par les archives. Peut-il y avoir une déclassification de ces documents pour faire la lumière sur ce qui s’est réellement passé, le nombre de soldats tués également ?
Jusqu’à aujourd’hui, l’État français a remis officiellement les archives en 2014 au président de la République Macky Sall. Je sais qu’à l’époque, le président Macky Sall avait commissionné – enfin, avait mis en place – une mission d’historiens et de personnalités sénégalaises qui avaient pour objectif de regarder toutes ces archives. Aujourd’hui, les archives qui ont été remises par la France au Sénégal ne sont pas ouvertes au public. Elles sont, je crois, uniquement ouvertes aux spécialistes. Il faudrait qu’on puisse y avoir accès et les regarder bien attentivement. Ensuite, comme je l’ai dit, au-delà des archives qui ont été remises à l’époque, on ne sait pas ce qui avait été mis en 1944, donc, on n’est pas en capacité aujourd’hui de dire ce qui s’est exactement passé.
La priorité, à mon sens, ce sont vraiment les fouilles des fosses communes qui permettront d’avoir un bilan officiel, car c’est ce que demandent les descendants. C’est ce que demandent aussi les historiens et historiennes qui travaillent sur ces sujets et c’est ce qui permettra d’avoir un chiffre très proche de la réalité. Aujourd’hui, le chiffre officiel est de 35 morts et 70 blessés. En 2014, quand François Hollande avait pris la parole, il avait prononcé un discours assez fort […] sur place. Il avait été invité par le président Macky Sall, donc il était sur place. En 2016, son ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault était retourné aussi à Thiaroye. Ils avaient tous les deux reconnu le fait que le chiffre de 35 morts n’était pas forcément un chiffre proche de la réalité. Et aujourd’hui, concrètement, ce qui permettrait d’avoir un chiffre exact, ce sont les fouilles des fosses communes où auraient été jetés ces malheureux soldats massacrés.
Revenons sur la réaction d’Ousmane Sonko au Sénégal, Premier ministre. Il explique que ce n’est pas à la France de fixer unilatéralement le nombre d’Africains trahis, assassinés, après avoir contribué à la sauver, ni le type et la portée de la reconnaissance et des réparations qu’ils méritent. Il est Premier ministre et il réagit en tant que président du Pastef. Dans les faits, ce n’est pas une réaction des autorités, mais il est tout de même chef du gouvernement. Sa parole est donc vue ainsi. Comment la comprendre ?
Pour le coup, je n’ai pas les tenants et aboutissants des échanges qui ont eu lieu entre l’État français et l’État sénégalais sur ce sujet, même si je sais que le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le président de la République Emmanuel Macron ont évoqué le cas de Thiaroye lors de la visite officielle du président de la République sénégalaise il y a environ trois semaines, un mois. Là, c’est vrai qu’il réagit en tant que président du Pastef, donc je n’ai pas de réaction particulière à avoir sur celle-ci. Néanmoins, je pense qu’il est important de noter que cela reste une avancée extrêmement importante et qu’il faut pouvoir justement se saisir de cette avancée et du travail qui a été fait aussi par les historiens sénégalais sur cette mention et de voir de quelle manière on peut avancer dans le bon sens.
C’était la suite de la politique africaine d’Emmanuel Macron dans les pas de François Hollande. C’est une suite logique vers l’ouverture ?
Oui, c’est une suite logique et un choix cohérent. En réalité, on est dans une année où l’on parle du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Ce qu’il faut mentionner aussi, c’est qu’on est sur le 80e anniversaire de la libération de la France dont le 80e anniversaire du débarquement de Provence. Un débarquement […] avec 235 000 combattants français dont 90% étaient issus des anciennes troupes coloniales, donc du Sénégal, d’Algérie, du Maroc, du Pacifique et des Antilles. Et il est aussi important de marquer cette date d’anniversaire par l’héroïsme de ces anciens soldats et qui ont débarqué dans le sud de la France le 15 août 1944.