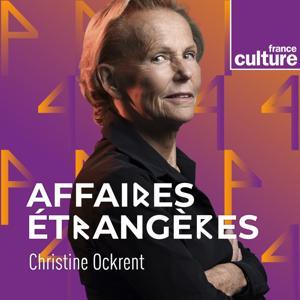Dispositif policier extrêmement important aujourd'hui à Lyon dans le Sud-Est de la France, à l'occasion de la marche en hommage à Quentin Deranque, le jeune militant d'extrême droite tué la semaine dernière à la suite d'une rixe avec des membres présumés de l'ultra-gauche. Qui sont ces groupuscules qui se battent dans les rues de Lyon ? Pour comprendre les enjeux de cette actualité mouvementée lyonnaise, Olivier Guyottot, enseignant-chercheur à l'INSEEC Grande École, est notre invité international de la mi-journée.
RFI : La mort de Quentin Deranque est sans doute l'affaire la plus marquante de ces dernières années à Lyon. Mais il faut aussi souligner que ces affrontements ne sont pas nouveaux entre groupes d'extrême droite et d'extrême gauche. Pour ne donner qu'un seul chiffre, le média Rue89 Lyon a recensé entre 2015 et 2025, près de 102 actes violents qui visaient principalement, selon ce média, des militants de gauche ou des personnes racisées. Alors, de votre point de vue, pourquoi est-ce que Lyon concentre-t-elle autant de groupes radicaux agressifs ? Quelle est la spécificité de cette ville ?
Olivier Guyottot : C'est vrai qu'historiquement, il y a toujours eu pas mal de groupuscules qui se sont affrontés. Je crois que c'est d'abord parce que c'est un point névralgique. C'est quand même une des très grosses villes françaises. Et puis historiquement, il y a eu notamment l'intégrisme catholique qui a été très présent. Donc, sur l'extrême droite, c'est quand même un des courants forts qui a structuré les groupuscules. Et l'extrême gauche est un peu en réaction, c'est un peu calé là-dessus. Et c'est vrai qu'historiquement, Lyon est une ville qui a toujours fait parler d'elle.
Mais ce n'est pas le seul endroit. On voit aujourd'hui, par exemple, qu’il y a une contre-manifestation aussi à Rennes qui est censée avoir commencé à 11 h. Donc il ne faut pas non plus donner l'impression que Lyon est le seul endroit où ça se passe. Mais c'est vrai qu’historiquement, et ces dernières années, ça a souvent été le théâtre de moments un peu tendus.
Effectivement, on voit des affrontements qui se sont multipliés. Vous faites bien de rappeler que ce n'est pas la seule ville où on voit ce genre d'affrontements, mais on a l'impression, en particulier avec l'affaire de la mort de Quentin Deranque, que tout explose, en particulier à Lyon. Selon les fameux chiffres de Rue89 Lyon, qui a beaucoup travaillé sur la question, que 70 % de ces affaires de violences entre groupuscules ou de groupuscules contre des citoyens, 70 % de ces affaires de violences sont restés impunis. Est-ce qu'il y a aussi une forme de prise de conscience, peut-être un peu trop tardive, du problème ?
Alors à chaque fois qu'il se passe un drame, quelque part, ça revient sur le devant de la scène. Après, l'histoire de l'extrême droite et l'histoire de l'extrême gauche a toujours été jalonnée de groupuscules plus ou moins violents. C'est vrai que politiquement, ces dernières années, il y a eu pas mal de dissolutions pour essayer d'éviter ce genre de phénomène. Au final, ça n'a pas eu forcément l'effet voulu parce que de ces petits groupes qui étaient un peu divisés, ça a quand même rassemblé les énergies autour notamment de la théorie du « grand remplacement ». Et Quentin Deranque est un bon exemple, de quelqu'un qui est passé de courants en courants.
Il était entré via la voie du catholicisme intégriste ?
Exactement. Donc finalement, le focus idéologique n'est plus la chose la plus importante, qui était vraiment un diviseur fort. Il y a quelques années, j'ai fait ma thèse autour de ça, il y avait vraiment des courants qui avaient du mal à être ensemble. Et aujourd'hui, on voit que ces mouvements, dans une sorte de forme moderne, les jeunes sont plus intéressés par cette espèce de menace plus globale de « grand remplacement » que par un axe idéologique un peu strict.
Et en face, on voit donc de l'autre côté, dans un mouvement parallèle, les mouvements d'ultra-gauche s'organiser aussi, sans doute, même si évidemment ce n'est pas forcément la meilleure solution, loin de là, pour répondre à cette organisation de l'extrême droite.
Oui, tout à fait. Alors les deux mouvements se sont construits en opposition, mais ils existent en dehors de cette opposition, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Après, ce qui se passe aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, c'est qu'on a des représentations politiques très nettes qui sont un peu l'incarnation, avec la montée du RN et Bardella – et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on n'entend pas Marine Le Pen parler de ça, c'est vraiment Bardella qui est dessus – ; et puis de l'autre côté, LFI, avec l'histoire de La Jeune Garde.
L’un des députés LFI, Raphaël Arnault, est l'un des fondateurs de La Jeune Garde, qui est mise en cause dans cette affaire et qui est d'ailleurs déjà dissoute.
Exactement. Et c'est vrai que par rapport aux enjeux qu'il y a aujourd'hui, qui sont des enjeux de manifestation, d'un équilibre entre l'ordre et la liberté de manifester, qui ont justifié le fait que le ministre Nuñez accepte cette manifestation, on a une dimension politique qui est beaucoup plus stratégique et qui est beaucoup plus importante, surtout dans l'optique, un, des municipales et, deux, de la présidentielle.
Là, on voit bien qu'il y a quand même une recomposition autour, notamment par rapport à Jordan Bardella, de l'idée d'un cordon sanitaire par rapport à LFI. Et pas seulement par rapport à eux, d'un rapprochement aussi vis-à-vis de la droite traditionnelle en disant : nous, on ne participera pas. Il a quand même interdit aux parlementaires RN d'aller à cette manifestation. Et c'est une manière de dire : voilà, la dédiabolisation qu’a mise en place Marine Le Pen, on arrive à un stade où on y est vraiment.
Dans un sens, ça répond aussi aux problèmes qu'il y avait eu lors des législatives anticipées, où il était censé un peu devenir Premier ministre, il était le favori et il n'avait pas su maîtriser les éléments instables, les éléments racistes.
Ceux qu'on a appelés les brebis galeuses du RN.
Exactement. Et donc là, on voit bien qu'il anticipe ça en vue des municipales, mais surtout de la présidentielle. Et puis de l'autre côté, vous avez LFI, vous avez le PS, vous avez la gauche. Et comment se comporter par rapport à ce sujet-là ? C'est à dire que par rapport à ça, effectivement, les alliances PS et LFI, comment elles vont se mettre en place avec les écologistes par rapport aux municipales et par rapport à la présidentielle ? Effectivement, cette affaire de Quentin Deranque, elle illustre cette espèce de question et on va voir ce qui va se passer après la manifestation.
À lire aussiMort de Quentin Deranque: la marche en hommage au militant autorisée malgré les craintes de heurts