
Sign up to save your podcasts
Or




L’agriculture comme on l'a pratique aujourd’hui est la première cause de l’effondrement du vivant. Dans les négociations internationales pour tenter de sauver la nature c’est donc un sujet incontournable mais qui est pourtant bien souvent mis de côté. Alors que s'est ouverte hier la COP16 biodiversité à Cali en Colombie, le lourd impact de notre système de production agricole sur les plantes et les animaux de la planète restera-t-il encore une fois ignoré ?
Les scientifiques sont clairs : on ne pourra pas sauver le vivant sans changer notre agriculture. Les deux sont intimement liés. Depuis plus de 10 000 ans et les débuts de l'agriculture humaine, la biodiversité est en effet utilisée par l’homme pour produire à manger. Ce sont les insectes pollinisateurs indispensables à trois espèces cultivées sur quatre, ou les vers de terre et les micro-organismes qui font la fertilité des sols, ou encore la grande variété de plantes adaptées à des terroirs bien particuliers.
Sauf qu'après la Seconde Guerre mondiale, nous avons fait entrer l'agriculture dans une ère d'industrialisation et d'artificialisation. À l'époque, il fallait augmenter les rendements pour nourrir le monde après six ans de guerre et de destruction.
L’envers de la médaille c’est qu’aujourd'hui, « ce mode de production est la première cause de l'effondrement du vivant », explique Clélia Sirami, directrice de recherche et spécialiste du lien entre les pratiques agricoles et la biodiversité à l’Inrae (l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement).
« On va droit dans le mur »Ça n’est pas l'agriculture en tant que telle qui pose problème, mais cette façon intensive de la pratiquer qui est épuisante pour la planète. Pesticides, mécanisation, engrais, parcelles de plus en plus grandes et mises à nu… tout contribue à dégrader le sol qui se meurt. Les pesticides ont engendré des ravageurs de plus en plus coriaces et résistants tout en anéantissant les autres animaux. Le tout avec un bilan carbone désastreux. Les systèmes alimentaires et la déforestation qui va avec représentent 37% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
« On va droit dans le mur, il faut changer de modèle » alerte Selim Louafi, directeur adjoint pour la recherche et la stratégie au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad).
Pourtant, si cette transformation du modèle agricole actuel est essentielle aux yeux des scientifiques, le sujet est loin de faire l'unanimité auprès des négociateurs internationaux. Il a donné lieu à des discussions tendues lors de la dernière COP Biodiversité à Montréal en 2022, et risque d’être marginalisé à Cali cette année.
Les grands pays agricoles, comme le Brésil, l’Argentine ou l’Inde, qui ont basé leur modèle économique sur l'exportation de cultures intensives sont réticents. D'autres, comme les pays d'Europe, ont des discours plus ambitieux mais font face en interne à de puissants lobbys agricoles et des industries chimiques (celles qui produisent les engrais et pesticides) qui ont des moyens colossaux.
Financer la transition« En France et en Europe, on a tout un historique de cogestion des politiques publiques, qui ont été décidées conjointement par les gouvernements et ces syndicats agricoles, explique Clélia Sirami, cela a contribué à la dominance d’une certaine vision depuis longtemps. » Si cette vision est maintenue, « c’est parce que ces acteurs risquent d’être les perdants dans la transition ». Toutefois, ces syndicats ne sont pas forcément représentatifs de tous les agriculteurs. « Le milieu agricole est très hétérogène, nuance la chercheuse, et beaucoup d’agriculteurs sont conscients des problèmes et sont partants pour s’engager dans cette transition, à condition d’être soutenus pour le faire ». Elle plaide pour un financement à la hauteur du changement demandé.
Parmi les arguments des industriels revient souvent l’idée selon laquelle il est nécessaire de produire toujours plus pour nourrir une population en constante augmentation. « Mais est-ce que ce qu’on produit actuellement contribue réellement à l’alimentation humaine ? » interroge Clélia Sirami. « 30% de ce qu’on produit est gaspillé et une grosse partie de ce qu’on produit est exporté pour nourrir le bétail, or on sait qu’il nous faut manger moins de viande. » L’agriculture intensive ne répond donc pas tant à un enjeu de sécurité alimentaire qu’au maintien d’un système économique selon elle.
À lire aussiFrance: la difficile transition écologique des agriculteurs
L'agroécologie en solutionL’agro-industrie soutient également qu’un changement de modèle serait synonyme d’un retour en arrière avec une agriculture à la qualité et aux rendements incertains. Mais c’est déconsidérer les solutions apportées par l’agroécologie. La biodiversité n'est pas l'ennemie de l'agriculteur, au contraire explique Selim Louafi du Cirad. « Ces nouvelles pratiques cherchent à valoriser les éléments de la biodiversité présents dans les sols qu’on a eu tendance à voir uniquement sous un angle négatif », explique-t-il. « L’idée est justement d’amplifier, d’intensifier, dans les parcelles cultivées, ces processus écologiques qui servent à maximiser la photosynthèse, contrôler les populations de bio-agresseurs, réactiver les cycles nutritifs pour limiter l’usage d’intrants coûteux, etc. Et tout cela nécessite énormément de connaissances et de nouvelles technologies donc il ne s’agit pas d’un retour en arrière comme c’est souvent caricaturé ».
Concrètement, il peut s’agir de planter une haie, qui va héberger les prédateurs naturels des insectes ravageurs, de combiner plusieurs semences qui peuvent s’épauler l’une et l’autre, d’intercaler des cultures capables de fixer les éléments nutritifs dans le sol, apprendre à connaître quelles combinaisons d’organismes dans le sol optimisent sa fertilité…
Si la nature s’en trouverait mieux, « c’est aussi le cas de la santé des consommateurs et celle des travailleurs dans les champs » ajoute Selim Louafi. C’est aussi une transition nécessaire pour limiter le bouleversement climatique.
À lire aussiPourquoi l'agroécologie ne s'impose pas comme modèle agricole ?
 View all episodes
View all episodes


 By RFI
By RFI
L’agriculture comme on l'a pratique aujourd’hui est la première cause de l’effondrement du vivant. Dans les négociations internationales pour tenter de sauver la nature c’est donc un sujet incontournable mais qui est pourtant bien souvent mis de côté. Alors que s'est ouverte hier la COP16 biodiversité à Cali en Colombie, le lourd impact de notre système de production agricole sur les plantes et les animaux de la planète restera-t-il encore une fois ignoré ?
Les scientifiques sont clairs : on ne pourra pas sauver le vivant sans changer notre agriculture. Les deux sont intimement liés. Depuis plus de 10 000 ans et les débuts de l'agriculture humaine, la biodiversité est en effet utilisée par l’homme pour produire à manger. Ce sont les insectes pollinisateurs indispensables à trois espèces cultivées sur quatre, ou les vers de terre et les micro-organismes qui font la fertilité des sols, ou encore la grande variété de plantes adaptées à des terroirs bien particuliers.
Sauf qu'après la Seconde Guerre mondiale, nous avons fait entrer l'agriculture dans une ère d'industrialisation et d'artificialisation. À l'époque, il fallait augmenter les rendements pour nourrir le monde après six ans de guerre et de destruction.
L’envers de la médaille c’est qu’aujourd'hui, « ce mode de production est la première cause de l'effondrement du vivant », explique Clélia Sirami, directrice de recherche et spécialiste du lien entre les pratiques agricoles et la biodiversité à l’Inrae (l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement).
« On va droit dans le mur »Ça n’est pas l'agriculture en tant que telle qui pose problème, mais cette façon intensive de la pratiquer qui est épuisante pour la planète. Pesticides, mécanisation, engrais, parcelles de plus en plus grandes et mises à nu… tout contribue à dégrader le sol qui se meurt. Les pesticides ont engendré des ravageurs de plus en plus coriaces et résistants tout en anéantissant les autres animaux. Le tout avec un bilan carbone désastreux. Les systèmes alimentaires et la déforestation qui va avec représentent 37% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
« On va droit dans le mur, il faut changer de modèle » alerte Selim Louafi, directeur adjoint pour la recherche et la stratégie au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad).
Pourtant, si cette transformation du modèle agricole actuel est essentielle aux yeux des scientifiques, le sujet est loin de faire l'unanimité auprès des négociateurs internationaux. Il a donné lieu à des discussions tendues lors de la dernière COP Biodiversité à Montréal en 2022, et risque d’être marginalisé à Cali cette année.
Les grands pays agricoles, comme le Brésil, l’Argentine ou l’Inde, qui ont basé leur modèle économique sur l'exportation de cultures intensives sont réticents. D'autres, comme les pays d'Europe, ont des discours plus ambitieux mais font face en interne à de puissants lobbys agricoles et des industries chimiques (celles qui produisent les engrais et pesticides) qui ont des moyens colossaux.
Financer la transition« En France et en Europe, on a tout un historique de cogestion des politiques publiques, qui ont été décidées conjointement par les gouvernements et ces syndicats agricoles, explique Clélia Sirami, cela a contribué à la dominance d’une certaine vision depuis longtemps. » Si cette vision est maintenue, « c’est parce que ces acteurs risquent d’être les perdants dans la transition ». Toutefois, ces syndicats ne sont pas forcément représentatifs de tous les agriculteurs. « Le milieu agricole est très hétérogène, nuance la chercheuse, et beaucoup d’agriculteurs sont conscients des problèmes et sont partants pour s’engager dans cette transition, à condition d’être soutenus pour le faire ». Elle plaide pour un financement à la hauteur du changement demandé.
Parmi les arguments des industriels revient souvent l’idée selon laquelle il est nécessaire de produire toujours plus pour nourrir une population en constante augmentation. « Mais est-ce que ce qu’on produit actuellement contribue réellement à l’alimentation humaine ? » interroge Clélia Sirami. « 30% de ce qu’on produit est gaspillé et une grosse partie de ce qu’on produit est exporté pour nourrir le bétail, or on sait qu’il nous faut manger moins de viande. » L’agriculture intensive ne répond donc pas tant à un enjeu de sécurité alimentaire qu’au maintien d’un système économique selon elle.
À lire aussiFrance: la difficile transition écologique des agriculteurs
L'agroécologie en solutionL’agro-industrie soutient également qu’un changement de modèle serait synonyme d’un retour en arrière avec une agriculture à la qualité et aux rendements incertains. Mais c’est déconsidérer les solutions apportées par l’agroécologie. La biodiversité n'est pas l'ennemie de l'agriculteur, au contraire explique Selim Louafi du Cirad. « Ces nouvelles pratiques cherchent à valoriser les éléments de la biodiversité présents dans les sols qu’on a eu tendance à voir uniquement sous un angle négatif », explique-t-il. « L’idée est justement d’amplifier, d’intensifier, dans les parcelles cultivées, ces processus écologiques qui servent à maximiser la photosynthèse, contrôler les populations de bio-agresseurs, réactiver les cycles nutritifs pour limiter l’usage d’intrants coûteux, etc. Et tout cela nécessite énormément de connaissances et de nouvelles technologies donc il ne s’agit pas d’un retour en arrière comme c’est souvent caricaturé ».
Concrètement, il peut s’agir de planter une haie, qui va héberger les prédateurs naturels des insectes ravageurs, de combiner plusieurs semences qui peuvent s’épauler l’une et l’autre, d’intercaler des cultures capables de fixer les éléments nutritifs dans le sol, apprendre à connaître quelles combinaisons d’organismes dans le sol optimisent sa fertilité…
Si la nature s’en trouverait mieux, « c’est aussi le cas de la santé des consommateurs et celle des travailleurs dans les champs » ajoute Selim Louafi. C’est aussi une transition nécessaire pour limiter le bouleversement climatique.
À lire aussiPourquoi l'agroécologie ne s'impose pas comme modèle agricole ?
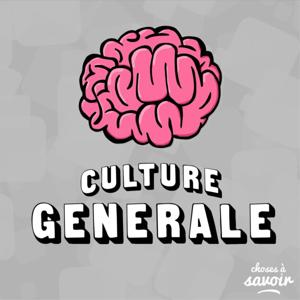
69 Listeners

24 Listeners

26 Listeners

12 Listeners

5 Listeners

15 Listeners

3 Listeners

8 Listeners

6 Listeners

0 Listeners

104 Listeners
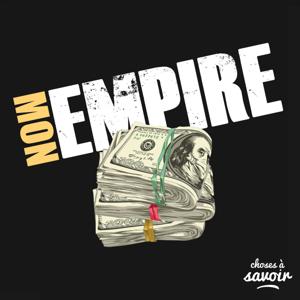
5 Listeners

13 Listeners

0 Listeners

176 Listeners

25 Listeners

3 Listeners

2 Listeners

0 Listeners

31 Listeners

20 Listeners

0 Listeners

2 Listeners

4 Listeners

1 Listeners
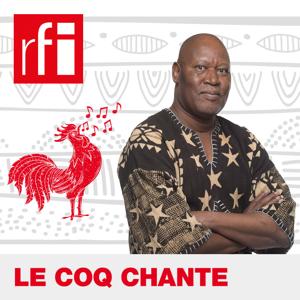
4 Listeners

0 Listeners

1 Listeners

18 Listeners
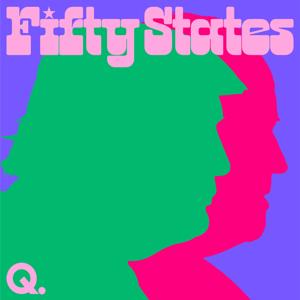
71 Listeners
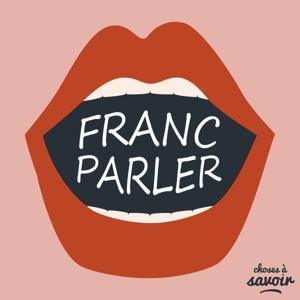
4 Listeners

1 Listeners

0 Listeners

0 Listeners

0 Listeners