
Sign up to save your podcasts
Or




C'est une lutte de près de dix ans qui a marqué le Canada. Celle du peuple autochtone Wet’suwet’en contre la construction du gazoduc Coastal GasLink, sur leur territoire, en Colombie britannique dans l'extrême ouest du pays. Une semaine d’audience judiciaire vient de se terminer. En jeu, les droits des peuples autochtones, essentiels pour préserver la nature.
À l'origine, un gazoduc de 670 km de long à travers les montagnes Rocheuses canadiennes pour transporter du gaz de schiste, particulièrement polluant, jusqu'à la côte où il doit être liquéfié pour être vendu sur les marchés asiatiques. Un projet voulu par les autorités canadiennes et les industriels, avec l'aval de certains représentants autochtone, mais auquel s’opposent les chefs héréditaires des Wet’suwet’en, une des Premières Nations canadiennes, dont le territoire est traversé par le gazoduc, car ils n'ont jamais été consultés alors que ces terres leur appartiennent. Elles n'ont jamais été cédées à l'État canadien.
« Cela a été prouvé, la Cours suprême, qui est la plus haute juridiction au Canada, a reconnu que notre Nation n’avait jamais capitulé, n’avait jamais vendu nos terres que, nous n’avons jamais signé aucun traité. Donc selon la loi canadienne elle-même, ces terres appartiennent à notre peuple », explique à RFI Freda Huson, l’une des figures de la lutte des Wet’suwet’en.
Des raids militarisés contre les opposantsEn dépit de cette reconnaissance, toutes leurs tentatives légales pour empêcher la construction du pipeline ont échoué. Les intérêts des autorités et de l’entreprise TC Energy qui gère le gazoduc ont été jugés plus importants que leurs réclamations et les promesses pour minimiser l’impact environnemental du projet ont su convaincre les juges.
« En trois ans, il y a eu trois raids militarisés contre nos barrages et nos checkpoints », poursuit Molly Wickham, aussi appelée Sleydo, une autre figure autochtone. « Notre peuple a été criminalisé, certains ont été arrêtés, chassés de notre propre territoire ». Comme la lutte des Wet’suwet’en a continué, la justice a fini par émettre une injonction pour les empêcher d’approcher le chantier. Molly Wickham fait partie d’un groupe arrêté en 2021 lors d’un de ces raids dont les Wet’suwet’en dénoncent l'ampleur de la répression. La GRC, la Gendarmerie royale du Canada, « avec ses hélicoptères, ses chiens et ses armes semi-automatiques » a lancé l’assaut face à de simples barricades de bois.
Depuis, la jeune femme est en procès. En janvier dernier, elle et deux autres opposants, ont été reconnus coupables d'outrage criminel, pour avoir voulu empêcher les travaux. Mais cette condamnation est suspendue pour l'instant, car les Wet’suwet’en estiment que la GRC fait un usage excessif de la force, qu'elle s'acharne sur eux. Si la justice le reconnaît alors les autochtones pourraient échapper à la prison. Verdict courant 2025.
« On ne veut pas perdre notre mode de vie »Au-delà de la lutte des Wet’suwet’en pour leurs droits à la terre, c’est une lutte pour sauver leur mode de vie et l’environnement qui se joue. Aujourd’hui, le gazoduc est terminé, mais Freda Huson ne sait pas s’il est entré en fonction. Ce qu’elle craint c’est que « toute la végétation et la vie sauvage soient anéanties sur son passage, que toutes les rivières, les cours d'eau qui abritent les saumons soient affectés. Nous sommes un peuple de pêcheurs, nous dépendons de ces saumons comme des baies, des remèdes naturels, des arbres qui purifient l'air… » explique-t-elle. « Nos voisins en Alberta ont déjà vécu cela : les peuples autochtones ont perdu leur tradition. Ils ne peuvent plus pêcher ni chasser à cause de la pollution et il y a de nombreux morts à cause de cancers rares. Leur histoire nous a alerté sur ce que sont vraiment ces industries extractives. Et on ne veut pas perdre notre mode de vie. C'est ce qui nous définit. Nous sommes la terre, la terre est en nous ».
La relation des peuples autochtones à la nature est bien plus forte que dans nos sociétés. « J’ai grandi loin de ma culture, et ce n’est qu’une fois adulte que je suis retournée sur mes terres ancestrales, parce que je venais d’avoir un enfant (maintenant j’en ai trois) », raconte Molly Wickham. « Et je veux qu’ils aient une bonne connexion à la terre, à leurs ancêtres, à la spiritualité et à leur culture. Et pour cela, nous devons avoir un environnement sain. Je ne prends pas cela pour acquis et c’est pour cela que je me bats. Pour mes enfants et tous les enfants à venir ».
Les peuples autochtones préservent mieux l'environnementAu contraire de Molly Wickham qui a découvert les traditions de son peuple sur le tard, Freda Huson a grandi avec, sur les terres des Wet’suwet’en. « Lorsque je suis partie faire mes études, je me suis déconnectée. J’ai commencé à travailler dans le système et à faire partie de la société colonisatrice. Mais quand je suis revenue, j’ai réalisé que jusqu’alors, quelque chose manquait, et j’ai compris que c’était la terre. Une fois que je suis revenue à la terre, j’ai senti que j’avais une raison d’être et que ma vie avait à nouveau de la valeur », témoigne-t-elle. « Nous sommes un peuple matriarcal, nous suivons nos mères et nos enfants nous suivent. Mes ancêtres ont gardé la terre intacte pour moi, pour que j’en profite. Maintenant c’est mon rôle de la garder intacte pour mes enfants et mes petits-enfants plus tard ».
Cette relation en symbiose avec la nature est justement ce qui est précieux. La science montre d'ailleurs que beaucoup de zones gérées par les peuples autochtones, sont en meilleure santé que les autres espaces naturels.
Le programme des Nations Unies pour l’environnement reconnaît qu’il sera impossible de maintenir le réchauffement climatique en dessous de + 2 degrés, c’est-à-dire à un niveau vivable, sans ces peuples et leurs savoirs.
Pour préserver notre planète, il est donc essentiel de reconnaître leurs droits à gérer leurs propres territoires. C'est ce que réclament Freda Huson et Molly Wickham à la justice canadienne.
La déclaration de l’ONU pour les peuples autochtones rappelle que « les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres », et qui stipule qu’ils ont le droit de contrôler ces terres et leurs ressources.
À lire aussiCanada: un chef autochtone déclaré premier «prisonnier d'opinion» par Amnesty International
 View all episodes
View all episodes


 By RFI
By RFI
C'est une lutte de près de dix ans qui a marqué le Canada. Celle du peuple autochtone Wet’suwet’en contre la construction du gazoduc Coastal GasLink, sur leur territoire, en Colombie britannique dans l'extrême ouest du pays. Une semaine d’audience judiciaire vient de se terminer. En jeu, les droits des peuples autochtones, essentiels pour préserver la nature.
À l'origine, un gazoduc de 670 km de long à travers les montagnes Rocheuses canadiennes pour transporter du gaz de schiste, particulièrement polluant, jusqu'à la côte où il doit être liquéfié pour être vendu sur les marchés asiatiques. Un projet voulu par les autorités canadiennes et les industriels, avec l'aval de certains représentants autochtone, mais auquel s’opposent les chefs héréditaires des Wet’suwet’en, une des Premières Nations canadiennes, dont le territoire est traversé par le gazoduc, car ils n'ont jamais été consultés alors que ces terres leur appartiennent. Elles n'ont jamais été cédées à l'État canadien.
« Cela a été prouvé, la Cours suprême, qui est la plus haute juridiction au Canada, a reconnu que notre Nation n’avait jamais capitulé, n’avait jamais vendu nos terres que, nous n’avons jamais signé aucun traité. Donc selon la loi canadienne elle-même, ces terres appartiennent à notre peuple », explique à RFI Freda Huson, l’une des figures de la lutte des Wet’suwet’en.
Des raids militarisés contre les opposantsEn dépit de cette reconnaissance, toutes leurs tentatives légales pour empêcher la construction du pipeline ont échoué. Les intérêts des autorités et de l’entreprise TC Energy qui gère le gazoduc ont été jugés plus importants que leurs réclamations et les promesses pour minimiser l’impact environnemental du projet ont su convaincre les juges.
« En trois ans, il y a eu trois raids militarisés contre nos barrages et nos checkpoints », poursuit Molly Wickham, aussi appelée Sleydo, une autre figure autochtone. « Notre peuple a été criminalisé, certains ont été arrêtés, chassés de notre propre territoire ». Comme la lutte des Wet’suwet’en a continué, la justice a fini par émettre une injonction pour les empêcher d’approcher le chantier. Molly Wickham fait partie d’un groupe arrêté en 2021 lors d’un de ces raids dont les Wet’suwet’en dénoncent l'ampleur de la répression. La GRC, la Gendarmerie royale du Canada, « avec ses hélicoptères, ses chiens et ses armes semi-automatiques » a lancé l’assaut face à de simples barricades de bois.
Depuis, la jeune femme est en procès. En janvier dernier, elle et deux autres opposants, ont été reconnus coupables d'outrage criminel, pour avoir voulu empêcher les travaux. Mais cette condamnation est suspendue pour l'instant, car les Wet’suwet’en estiment que la GRC fait un usage excessif de la force, qu'elle s'acharne sur eux. Si la justice le reconnaît alors les autochtones pourraient échapper à la prison. Verdict courant 2025.
« On ne veut pas perdre notre mode de vie »Au-delà de la lutte des Wet’suwet’en pour leurs droits à la terre, c’est une lutte pour sauver leur mode de vie et l’environnement qui se joue. Aujourd’hui, le gazoduc est terminé, mais Freda Huson ne sait pas s’il est entré en fonction. Ce qu’elle craint c’est que « toute la végétation et la vie sauvage soient anéanties sur son passage, que toutes les rivières, les cours d'eau qui abritent les saumons soient affectés. Nous sommes un peuple de pêcheurs, nous dépendons de ces saumons comme des baies, des remèdes naturels, des arbres qui purifient l'air… » explique-t-elle. « Nos voisins en Alberta ont déjà vécu cela : les peuples autochtones ont perdu leur tradition. Ils ne peuvent plus pêcher ni chasser à cause de la pollution et il y a de nombreux morts à cause de cancers rares. Leur histoire nous a alerté sur ce que sont vraiment ces industries extractives. Et on ne veut pas perdre notre mode de vie. C'est ce qui nous définit. Nous sommes la terre, la terre est en nous ».
La relation des peuples autochtones à la nature est bien plus forte que dans nos sociétés. « J’ai grandi loin de ma culture, et ce n’est qu’une fois adulte que je suis retournée sur mes terres ancestrales, parce que je venais d’avoir un enfant (maintenant j’en ai trois) », raconte Molly Wickham. « Et je veux qu’ils aient une bonne connexion à la terre, à leurs ancêtres, à la spiritualité et à leur culture. Et pour cela, nous devons avoir un environnement sain. Je ne prends pas cela pour acquis et c’est pour cela que je me bats. Pour mes enfants et tous les enfants à venir ».
Les peuples autochtones préservent mieux l'environnementAu contraire de Molly Wickham qui a découvert les traditions de son peuple sur le tard, Freda Huson a grandi avec, sur les terres des Wet’suwet’en. « Lorsque je suis partie faire mes études, je me suis déconnectée. J’ai commencé à travailler dans le système et à faire partie de la société colonisatrice. Mais quand je suis revenue, j’ai réalisé que jusqu’alors, quelque chose manquait, et j’ai compris que c’était la terre. Une fois que je suis revenue à la terre, j’ai senti que j’avais une raison d’être et que ma vie avait à nouveau de la valeur », témoigne-t-elle. « Nous sommes un peuple matriarcal, nous suivons nos mères et nos enfants nous suivent. Mes ancêtres ont gardé la terre intacte pour moi, pour que j’en profite. Maintenant c’est mon rôle de la garder intacte pour mes enfants et mes petits-enfants plus tard ».
Cette relation en symbiose avec la nature est justement ce qui est précieux. La science montre d'ailleurs que beaucoup de zones gérées par les peuples autochtones, sont en meilleure santé que les autres espaces naturels.
Le programme des Nations Unies pour l’environnement reconnaît qu’il sera impossible de maintenir le réchauffement climatique en dessous de + 2 degrés, c’est-à-dire à un niveau vivable, sans ces peuples et leurs savoirs.
Pour préserver notre planète, il est donc essentiel de reconnaître leurs droits à gérer leurs propres territoires. C'est ce que réclament Freda Huson et Molly Wickham à la justice canadienne.
La déclaration de l’ONU pour les peuples autochtones rappelle que « les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres », et qui stipule qu’ils ont le droit de contrôler ces terres et leurs ressources.
À lire aussiCanada: un chef autochtone déclaré premier «prisonnier d'opinion» par Amnesty International
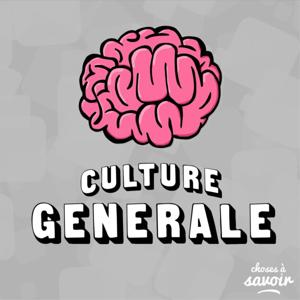
72 Listeners

24 Listeners

25 Listeners

12 Listeners

5 Listeners

15 Listeners

3 Listeners

8 Listeners

6 Listeners

0 Listeners

105 Listeners
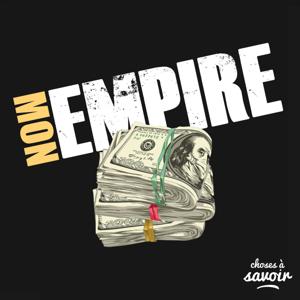
5 Listeners

12 Listeners

0 Listeners

176 Listeners

25 Listeners

3 Listeners

2 Listeners

0 Listeners

31 Listeners

20 Listeners

0 Listeners

2 Listeners

4 Listeners

1 Listeners
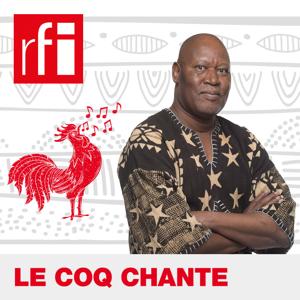
4 Listeners

0 Listeners

1 Listeners

18 Listeners
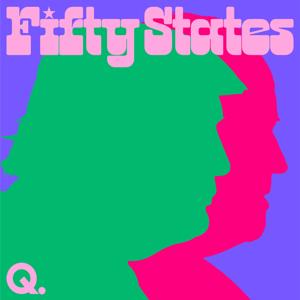
71 Listeners
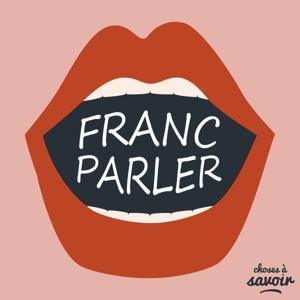
4 Listeners

1 Listeners

0 Listeners

0 Listeners

0 Listeners