
Sign up to save your podcasts
Or




« Cent jours : c’est le temps qu’il faut généralement avant de pouvoir juger l’action d’un gouvernement, relève Le Soir à Bruxelles. Mais avec Donald Trump, trente jours ont suffi pour qu’on ait le sentiment non seulement que les États-Unis ont totalement changé, mais que nous avons tous basculé dans un nouveau monde. On ne sait quel moment épingler pour exprimer cette stupéfaction, s’exclame le quotidien belge. Les négociateurs russes attablés avec les Américains pour discuter du sort de l’Ukraine ? Cette “Riviera“ à construire sur les gravats et les cendres de Gaza ? Le vice-président Vance humiliant en direct les Européens et crachant sur leurs valeurs ? Ou Elon Musk et ses techs boys fracassant, façon Die Hard, le cœur de l’État américain et terrorisant des milliers de fonctionnaires par une chasse aux sorcières 3.0 ? Impossible de choisir tant un moment succède à l’autre à une vitesse folle. (…) Sous Trump 1er, relève encore Le Soir, les Européens se réveillaient le matin en se demandant “qu’a-t-il tweeté ?“ ; pour Trump 2, la question au réveil est “qu’a-t-il décidé ?“. Un cessez-le-feu, des tarifs douaniers, une expulsion, une annexion, des négociations ou la suppression des pailles en carton : rien n’est plus inimaginable ! »
Business is business…« Trump : après un mois, le déluge », rebondit Libération à Paris.
En fait, « Trump applique le principe de “l’inondation de la zone“ chère à son ancien gourou, Steve Bannon, constate le journal : on submerge les médias, les adversaires politiques et les dirigeants internationaux d’annonces tonitruantes afin de les tétaniser. De fait, l’Amérique est tétanisée. Car elle a pour ainsi dire hérité de deux Donald Trump pour le prix d’un, et ça, ce n’était pas prévu, pointe Libération. On savait que le patron de Tesla, Elon Musk, était un de ses plus fervents soutiens, on n’imaginait pas qu’il deviendrait une sorte de président bis, détruisant de l’intérieur l’administration américaine comme on donne un coup de pied dans un château de sable. Avec un plan bien défini en tête : briser tous ceux qui peuvent nuire à son business. Le business, voilà le maître mot de ce nouveau mandat, s’exclame encore Libération. Tout est ramené à l’argent, qu’il s’agisse de Gaza, appelé à devenir la “Riviera du Moyen-Orient“ avec des gratte-ciel pour hommes d’affaires, ou de l’Ukraine, dont les sous-sols gorgés de terres rares pourraient servir à rembourser les milliards investis dans la guerre par l’administration Biden. Les humains ne comptent plus, seul subsiste le pouvoir de la machine et du billet vert ».
Des accords… pas la paix« Quand les États-Unis connaissent le prix et ignorent les valeurs », renchérit le Guardian à Londres. « Pour Trump, ses deux intérêts principaux – l’argent et le pouvoir – sont non seulement interdépendants mais également interchangeables, tout comme les objectifs des États-Unis et ses intérêts personnels lui semblent souvent indissociables (n’a-t-il pas créé sa propre cryptomonnaie quelques jours avant de revenir à la Maison-Blanche…). Lorsqu’il évoque l’avenir de l’Ukraine ou de Gaza, poursuit le Guardian, il ne parle pas de droits de l’homme et de sécurité, de vies et de foyers, mais il parle respectivement de l’acquisition par les États-Unis de 500 milliards de dollars de minerais et d’un “grand complexe immobilier“. Il croit en la nécessité de conclure des accords, pas de faire la paix ».
Vers un monde plus dangereux ?Sidération et inquiétude également dans les grands quotidiens américains…
« Trump est une machine à produire de l’indignation, soupire le Washington Post. Il semble prendre un plaisir pervers à dire des choses qui choquent. »
Le New York Times ne prend pas de gants non plus : « Trump se prosterne devant Poutine : attendez-vous à un monde plus dangereux », prévient le journal.
Le New York Times qui estime qu’au-delà de l’Ukraine, au-delà de l’Europe, « le plus grand cauchemar des relations internationales dans les années à venir serait peut-être une guerre entre les États-Unis et la Chine. Le président Joe Biden avait freiné les intentions belliqueuses des Chinois en travaillant en étroite collaboration avec ses alliés en Asie et en montrant clairement que la Russie payait un prix élevé pour son invasion de l’Ukraine. Si Donald Trump laisse la Russie gagner et rompt les relations avec nos alliés, alors, relève le quotidien new-yorkais, pourquoi la Chine n’attaquerait pas Taïwan (…). L’après-Seconde Guerre mondiale a été une époque historique remarquable de huit décennies de prospérité et de progrès. Mais aujourd’hui, conclut le New York Times, les lampes s’éteignent dans toute l’Europe et nous devons nous préparer à un monde plus dangereux ».
 View all episodes
View all episodes


 By RFI
By RFI




4.2
55 ratings

« Cent jours : c’est le temps qu’il faut généralement avant de pouvoir juger l’action d’un gouvernement, relève Le Soir à Bruxelles. Mais avec Donald Trump, trente jours ont suffi pour qu’on ait le sentiment non seulement que les États-Unis ont totalement changé, mais que nous avons tous basculé dans un nouveau monde. On ne sait quel moment épingler pour exprimer cette stupéfaction, s’exclame le quotidien belge. Les négociateurs russes attablés avec les Américains pour discuter du sort de l’Ukraine ? Cette “Riviera“ à construire sur les gravats et les cendres de Gaza ? Le vice-président Vance humiliant en direct les Européens et crachant sur leurs valeurs ? Ou Elon Musk et ses techs boys fracassant, façon Die Hard, le cœur de l’État américain et terrorisant des milliers de fonctionnaires par une chasse aux sorcières 3.0 ? Impossible de choisir tant un moment succède à l’autre à une vitesse folle. (…) Sous Trump 1er, relève encore Le Soir, les Européens se réveillaient le matin en se demandant “qu’a-t-il tweeté ?“ ; pour Trump 2, la question au réveil est “qu’a-t-il décidé ?“. Un cessez-le-feu, des tarifs douaniers, une expulsion, une annexion, des négociations ou la suppression des pailles en carton : rien n’est plus inimaginable ! »
Business is business…« Trump : après un mois, le déluge », rebondit Libération à Paris.
En fait, « Trump applique le principe de “l’inondation de la zone“ chère à son ancien gourou, Steve Bannon, constate le journal : on submerge les médias, les adversaires politiques et les dirigeants internationaux d’annonces tonitruantes afin de les tétaniser. De fait, l’Amérique est tétanisée. Car elle a pour ainsi dire hérité de deux Donald Trump pour le prix d’un, et ça, ce n’était pas prévu, pointe Libération. On savait que le patron de Tesla, Elon Musk, était un de ses plus fervents soutiens, on n’imaginait pas qu’il deviendrait une sorte de président bis, détruisant de l’intérieur l’administration américaine comme on donne un coup de pied dans un château de sable. Avec un plan bien défini en tête : briser tous ceux qui peuvent nuire à son business. Le business, voilà le maître mot de ce nouveau mandat, s’exclame encore Libération. Tout est ramené à l’argent, qu’il s’agisse de Gaza, appelé à devenir la “Riviera du Moyen-Orient“ avec des gratte-ciel pour hommes d’affaires, ou de l’Ukraine, dont les sous-sols gorgés de terres rares pourraient servir à rembourser les milliards investis dans la guerre par l’administration Biden. Les humains ne comptent plus, seul subsiste le pouvoir de la machine et du billet vert ».
Des accords… pas la paix« Quand les États-Unis connaissent le prix et ignorent les valeurs », renchérit le Guardian à Londres. « Pour Trump, ses deux intérêts principaux – l’argent et le pouvoir – sont non seulement interdépendants mais également interchangeables, tout comme les objectifs des États-Unis et ses intérêts personnels lui semblent souvent indissociables (n’a-t-il pas créé sa propre cryptomonnaie quelques jours avant de revenir à la Maison-Blanche…). Lorsqu’il évoque l’avenir de l’Ukraine ou de Gaza, poursuit le Guardian, il ne parle pas de droits de l’homme et de sécurité, de vies et de foyers, mais il parle respectivement de l’acquisition par les États-Unis de 500 milliards de dollars de minerais et d’un “grand complexe immobilier“. Il croit en la nécessité de conclure des accords, pas de faire la paix ».
Vers un monde plus dangereux ?Sidération et inquiétude également dans les grands quotidiens américains…
« Trump est une machine à produire de l’indignation, soupire le Washington Post. Il semble prendre un plaisir pervers à dire des choses qui choquent. »
Le New York Times ne prend pas de gants non plus : « Trump se prosterne devant Poutine : attendez-vous à un monde plus dangereux », prévient le journal.
Le New York Times qui estime qu’au-delà de l’Ukraine, au-delà de l’Europe, « le plus grand cauchemar des relations internationales dans les années à venir serait peut-être une guerre entre les États-Unis et la Chine. Le président Joe Biden avait freiné les intentions belliqueuses des Chinois en travaillant en étroite collaboration avec ses alliés en Asie et en montrant clairement que la Russie payait un prix élevé pour son invasion de l’Ukraine. Si Donald Trump laisse la Russie gagner et rompt les relations avec nos alliés, alors, relève le quotidien new-yorkais, pourquoi la Chine n’attaquerait pas Taïwan (…). L’après-Seconde Guerre mondiale a été une époque historique remarquable de huit décennies de prospérité et de progrès. Mais aujourd’hui, conclut le New York Times, les lampes s’éteignent dans toute l’Europe et nous devons nous préparer à un monde plus dangereux ».

16 Listeners

32 Listeners

7 Listeners

195 Listeners

40 Listeners

28 Listeners

13 Listeners

14 Listeners

42 Listeners
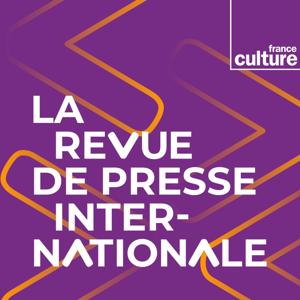
40 Listeners

12 Listeners

25 Listeners

7 Listeners

29 Listeners

3 Listeners

12 Listeners

0 Listeners

0 Listeners

0 Listeners

28 Listeners

1 Listeners

17 Listeners

4 Listeners

1 Listeners
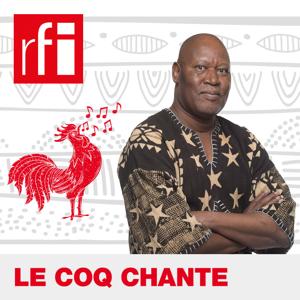
4 Listeners

3 Listeners

3 Listeners

0 Listeners

0 Listeners

1 Listeners

0 Listeners

24 Listeners

1 Listeners

0 Listeners

0 Listeners